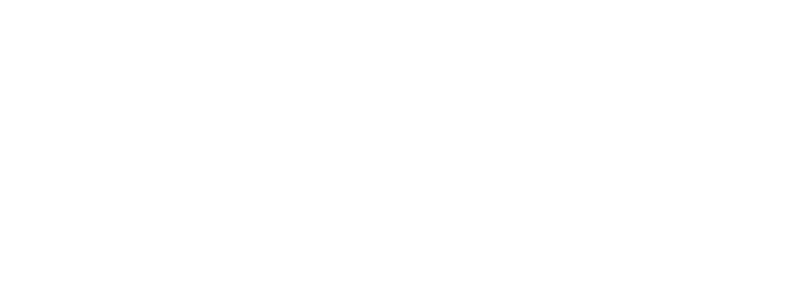La Libération de Brest
4 participants
Page 1 sur 1
 La Libération de Brest
La Libération de Brest
Brest Sous 4 000 tonnes de Bombes :
965 civils tués . 10 000 immeubles détruits . Pourquoi la Libération de Brest a-t-elle été si chèrement payée par la ville ? La réponse à cette question nécessite un retour arrière de cinq années. Les approvisionnements de la Grande-Bretagne se faisant principalement par mer, les Allemands s'en sont évidemment pris aux navires de commerce Britanniques ou Alliés dans l'Atlantique.
La situation géographique du port de Brest, base avancée dans l'Atlantique, lui conférait donc un intérêt stratégique capital. L'ennemi pourrait y construire une base sous-marine pour ses U-Boot qui allaient couler de très nombreux navires marchands alliés? Cet U-Binker fut réalisé en 1941-1942. Dans le même temps, les ports de Lorient, Saint-Nazaire, La Pallice et Bordeaux en furent aussi dotés. A Brest, l'occupant allait aussi bénéficier d'un arsenal où il pourrait entretenir et réparer ses navires.
Cette base stratégique de premier ordre devait bien sûr être particulièrement protégée. C'est pourquoi, pendant les années d'occupation, les Allemands ont fait de la défense de Brest, la meilleure qu'ils aient mis en place selon les rapports du Département de la Guerre des Etats Unis. D'où la difficulté d'investir cette forteresse qu'ils pensaient peut être imprenable et qu'ils ont âprement défendue. Les combats terrestre acharnés, appuyés par des bombardements massifs, n'ont alors laissé de la ville qu'un champ de ruines. Et à la fin du siège, l'occupant a incendié au lance-flammes, les immeubles du Brest intra-muros qui étaient encore debout.
Quatre ceintures de Forts et de Bastions :
En fait, les Allemands avaient utilisé en les modernisant et en les adaptant, les fortifications vieilles de plusieurs siècles. Cette défense comportait quatre ceintures de forts et de bastions armés par 50 000 hommes terrés pour la plupart, dans des casernements souterrains.
Chaque fort abritait au moins cinq canons de 105 mm et de nombreuses de 75 mm et de 88 , à l'abri de deux mètres cinquante de béton. Ces ensembles étaient complètés par une foule de canons anti-chars.
A l'extérieur, des remparts avaient en outre, été équipé d'un fossé anti-chars doté de pièces de 75 et de 88 plus une ceinture de canons anti-aériens de 40 mm; toutes des armes embusquées sous des cuirasses de béton.
Les Bombardiers appuient l'infanterie :
C'est à cette citadelle puissamment équipée et armée, que se sont trouvées confrontées les 2ème , 8ème et 29ème divisions d'infanterie américaines. Elles ont été efficacement épaulée par les forces tactiques de la 9ème armée de l'air américaine composée de chasseurs-bombardiers "Thunderbolt" "Lighting" et "Mustang" . Ces appareils appuyèrent directement les troupes terrestres en intervenant juste devant elles et en même temps qu'elles, pour compléter les effets de l'artillerie lourde.
Les chasseurs-bombardiers achevaient le travail commencé par les canons et obligeaient l'ennemi à rester à l'abri pendant que l'infanterie américaine donnait l'assaut. Durant le siège, les chasseurs-bombardiers accomplirent ainsi 331 missions ( soit un total de 3 698 sorties ) larguant plus de 1 000 tonnes de bombes.
La 8ème division attaquait au nord, la 2ème à l'est et la 29ème à l'ouest. Elles progressaient derrière les chasseurs-bombardiers pour bénéficier aussitôt de leur passage. Des contacts radio permanents entre les troupes terrestres et aériennes, permettaient la coordination des assauts.
Au cours de ces semaines, les forteresses volantes et autres unités lourdes procédèrent également à de multiples attaques.
Cinq années de raids aériens :
Les bombardements avaient commencé bien avant la bataille de Brest. La première alerte remontait en effet au 16 novembre 1939. On se souvient aussi que le 14 juin 1940, notamment, des appareils allemands avaient essayé de toucher le cuirassé "Richelieu" .
Les attaques Britanniques contre la cité occupée avaient débuté dés 1940. Et pour la seule année 1941, on avait déploré 275 morts et 358 blessés, avec 200 heures d'alerte. Le séjour à Brest des Croiseurs "Scharnhorst" et Gneisnau", puis du "Prince Eugène" en fut la cause. Pour assurer la sécurité de ses convois dans l'Atlantique, la Grande Bretagne devait en effet mettre hors de combat, ces unités redoutables.
Lorsqu'elles touchèrent Brest, le 23 mars 1941, elles rentraient d'une campagne de seux mois au cours de laquelle elles avaient envoyé par le fond seize bâtiments de commerce, essentiellement Britanniques. Les Bombardements de "Royal Air Force" allèrent donc en se multipliant.
Le 6 avril 1941, un appareil volant très bas envoya une torpille sur le "Gneisnau" qui venait de sortir de cale sèche, brisant ainsi un arbre d'hélice et perçant la coque. Quatre jours plus tard, alors que le croiseur se trouvait en bassin à Laninon, il reçut quatre bombes. Il subit encore d'autres dégâts le 25 avril. En définitive, son escale, qui devait être courte, dura dix mois et demi.
Le 24 juillet 1941 :
Malheureusement, toutes les bombes de la R.A.F. n'atteignaient pas les objectifs. De sorte que beaucoup de civils furent tués ou blessés dans les immeubles détruits ou endommagés. Aussi à plusieurs reprises le Sous-Préfet avait-il invité la population à quitter la ville. L'exode allait d'ailleurs s'intensifier après le bombardement si meurtrier du 24 juillet 1941, le premier à être intervenu en plein jour. Cet après midi là de 14 h à 16 h 20, une cinquantaine d'immeubles furent ravagés : On dénombra 78 morts et 83 blessés.
De 1939 à 1944, 4 000 tonnes de bombes sont tombées sur brest, tuant 965 civils, anéantissant 4 875 immeubles et endommageant sérieusement 5 103 autres. Par ailleurs une soixantaine de Brestois ont été fusillés, 146 déportés et 373 ont péri dans l'explosion de l'abri Sadi-Carnot.
Yvonne, la paysanne de Milizac :
Milizac l'a vu naître, et elle en a décrit la vie quotidienne dans deux livres nés de longues conversations avec Jean Ropars, l'ancien directeur de l'hôpital Morvan : "Au pays d'Yvonne" qui lui valut de faire une prestation mémorable sur le plateau de "Caractères" à la Télévision (émission de Bernard Rapp) et "L'amour de la terre" , deux ouvrages qui constituent un précieux document sur le monde rural dans le Léon.
Yvonne Bonnefoi-Riou avait 19 ans en 1944. Elle se souvient des événements qui ont marqué la Libération tels qu'elle les a vécu dans l'exploitation où elle travaillait : " Le 7 août 1944, je suis montée en compagnie de mes deux frères sur un tas de paille, car nous venions d'entendre un bruit anormal. C'était les chars américains. Un lieutenant qui se tenait dans le premier tank a sorti un drapeau blanc, il est allé demander aux Allemands qui étaient depuis plusieurs années au bord de l'étang, de se rendre. L'officier américain a été tué aussitôt ".
Un géant allemand poseur de mines :
Yvonne poursuit son récit : " D'où nous étions, nous apercevions des baraques en feu. Nous sommes descendus sur la route avec des sceaux de lait pour abreuver à volonté les premiers fantassins qui braquaient leurs fusils en direction des talus. A 15 h deux Allemands qui sortaient du souterrain ont été abattus par les GI's ".
" Dans la soirée j'ai vu faire un prisonnier, puis un tank américain enlisé dans notre prairie a été détruit pour le soustraire à l'ennemi. Le lendemai, les soldats US se sont repliés vers Lesneven, laissant la garde du carrefour des Trois Curés aux hommes dela Résistance. Ces derniers par une nuit de clair de lune, entendirent des pas et virent une immense silhouette casquée déboucher d'un chemin creux. Ils firent feu et abattirent le géant qui portait une mine afin de la placer au croisement ".
" Ensuite, le carrefour resta sans garde. Notre patronne alla en chaussons voir ses betteraves au coin du champ. Six ou sept Allemands y dormaient.Son frère prit son vélo pour avertir les résistants à Bourg-Blanc. Ils arrivèrent en camion, qu'ils laissèrent à bonne distance et s'approchèrent silencieusement avant d'ouvrir le feu. Deux soldats allemands furent abattus. Les autres s'enfuirent à travers la campagne vers Gouesnou ".
Une centaine de GI's à la ferme :
Quelques jours plus tard, Yvonne et les siens virent passer un convoi qu'elle évalua à trois mille Allemands battre en retraite vers Brest.
" Après cela, les Américains se sont installés dans nos champs. Ils ont creusé des trous énormes, dissimulant trois canons de très gros calibres recouverts d'arbustes et de branchages. Deux mitrailleuses anti-aériennes étaient placées prés de nos bâtiments. Lorsque les obus partaient, nos toits se soulevaient et redescendaient à la même place. La peur nous tenaillait…
… Peu de temps avant la reddition de Brest, je me rappelle que mon beau-père, âgé de 76 ans, parti chercher ses chevaux, fut encerclé par treize allemands cachés derrière un bosquet. Comme il parlait trop fort, un soldat le frappa d'un coup de crosse. Il leur dit : "Vous n'allez quand même tuer un vieux comme moi. J'ai mes enfants prisonniers chez vous ". Deux heures après , ils l'ont relâché…
…Après le 18 septembre, les américains restèrent réviser leur matériel. Ils venaient du Massachussetts et du Michigan. C'est peut être eux qui ont libéré mon fiancé prisonnier depuis le début de la guerre. Il n'est revenu que le 23 mai 1945, comme tant d'autres prisonniers " .
965 civils tués . 10 000 immeubles détruits . Pourquoi la Libération de Brest a-t-elle été si chèrement payée par la ville ? La réponse à cette question nécessite un retour arrière de cinq années. Les approvisionnements de la Grande-Bretagne se faisant principalement par mer, les Allemands s'en sont évidemment pris aux navires de commerce Britanniques ou Alliés dans l'Atlantique.
La situation géographique du port de Brest, base avancée dans l'Atlantique, lui conférait donc un intérêt stratégique capital. L'ennemi pourrait y construire une base sous-marine pour ses U-Boot qui allaient couler de très nombreux navires marchands alliés? Cet U-Binker fut réalisé en 1941-1942. Dans le même temps, les ports de Lorient, Saint-Nazaire, La Pallice et Bordeaux en furent aussi dotés. A Brest, l'occupant allait aussi bénéficier d'un arsenal où il pourrait entretenir et réparer ses navires.
Cette base stratégique de premier ordre devait bien sûr être particulièrement protégée. C'est pourquoi, pendant les années d'occupation, les Allemands ont fait de la défense de Brest, la meilleure qu'ils aient mis en place selon les rapports du Département de la Guerre des Etats Unis. D'où la difficulté d'investir cette forteresse qu'ils pensaient peut être imprenable et qu'ils ont âprement défendue. Les combats terrestre acharnés, appuyés par des bombardements massifs, n'ont alors laissé de la ville qu'un champ de ruines. Et à la fin du siège, l'occupant a incendié au lance-flammes, les immeubles du Brest intra-muros qui étaient encore debout.
Quatre ceintures de Forts et de Bastions :
En fait, les Allemands avaient utilisé en les modernisant et en les adaptant, les fortifications vieilles de plusieurs siècles. Cette défense comportait quatre ceintures de forts et de bastions armés par 50 000 hommes terrés pour la plupart, dans des casernements souterrains.
Chaque fort abritait au moins cinq canons de 105 mm et de nombreuses de 75 mm et de 88 , à l'abri de deux mètres cinquante de béton. Ces ensembles étaient complètés par une foule de canons anti-chars.
A l'extérieur, des remparts avaient en outre, été équipé d'un fossé anti-chars doté de pièces de 75 et de 88 plus une ceinture de canons anti-aériens de 40 mm; toutes des armes embusquées sous des cuirasses de béton.
Les Bombardiers appuient l'infanterie :
C'est à cette citadelle puissamment équipée et armée, que se sont trouvées confrontées les 2ème , 8ème et 29ème divisions d'infanterie américaines. Elles ont été efficacement épaulée par les forces tactiques de la 9ème armée de l'air américaine composée de chasseurs-bombardiers "Thunderbolt" "Lighting" et "Mustang" . Ces appareils appuyèrent directement les troupes terrestres en intervenant juste devant elles et en même temps qu'elles, pour compléter les effets de l'artillerie lourde.
Les chasseurs-bombardiers achevaient le travail commencé par les canons et obligeaient l'ennemi à rester à l'abri pendant que l'infanterie américaine donnait l'assaut. Durant le siège, les chasseurs-bombardiers accomplirent ainsi 331 missions ( soit un total de 3 698 sorties ) larguant plus de 1 000 tonnes de bombes.
La 8ème division attaquait au nord, la 2ème à l'est et la 29ème à l'ouest. Elles progressaient derrière les chasseurs-bombardiers pour bénéficier aussitôt de leur passage. Des contacts radio permanents entre les troupes terrestres et aériennes, permettaient la coordination des assauts.
Au cours de ces semaines, les forteresses volantes et autres unités lourdes procédèrent également à de multiples attaques.
Cinq années de raids aériens :
Les bombardements avaient commencé bien avant la bataille de Brest. La première alerte remontait en effet au 16 novembre 1939. On se souvient aussi que le 14 juin 1940, notamment, des appareils allemands avaient essayé de toucher le cuirassé "Richelieu" .
Les attaques Britanniques contre la cité occupée avaient débuté dés 1940. Et pour la seule année 1941, on avait déploré 275 morts et 358 blessés, avec 200 heures d'alerte. Le séjour à Brest des Croiseurs "Scharnhorst" et Gneisnau", puis du "Prince Eugène" en fut la cause. Pour assurer la sécurité de ses convois dans l'Atlantique, la Grande Bretagne devait en effet mettre hors de combat, ces unités redoutables.
Lorsqu'elles touchèrent Brest, le 23 mars 1941, elles rentraient d'une campagne de seux mois au cours de laquelle elles avaient envoyé par le fond seize bâtiments de commerce, essentiellement Britanniques. Les Bombardements de "Royal Air Force" allèrent donc en se multipliant.
Le 6 avril 1941, un appareil volant très bas envoya une torpille sur le "Gneisnau" qui venait de sortir de cale sèche, brisant ainsi un arbre d'hélice et perçant la coque. Quatre jours plus tard, alors que le croiseur se trouvait en bassin à Laninon, il reçut quatre bombes. Il subit encore d'autres dégâts le 25 avril. En définitive, son escale, qui devait être courte, dura dix mois et demi.
Le 24 juillet 1941 :
Malheureusement, toutes les bombes de la R.A.F. n'atteignaient pas les objectifs. De sorte que beaucoup de civils furent tués ou blessés dans les immeubles détruits ou endommagés. Aussi à plusieurs reprises le Sous-Préfet avait-il invité la population à quitter la ville. L'exode allait d'ailleurs s'intensifier après le bombardement si meurtrier du 24 juillet 1941, le premier à être intervenu en plein jour. Cet après midi là de 14 h à 16 h 20, une cinquantaine d'immeubles furent ravagés : On dénombra 78 morts et 83 blessés.
De 1939 à 1944, 4 000 tonnes de bombes sont tombées sur brest, tuant 965 civils, anéantissant 4 875 immeubles et endommageant sérieusement 5 103 autres. Par ailleurs une soixantaine de Brestois ont été fusillés, 146 déportés et 373 ont péri dans l'explosion de l'abri Sadi-Carnot.
Yvonne, la paysanne de Milizac :
Milizac l'a vu naître, et elle en a décrit la vie quotidienne dans deux livres nés de longues conversations avec Jean Ropars, l'ancien directeur de l'hôpital Morvan : "Au pays d'Yvonne" qui lui valut de faire une prestation mémorable sur le plateau de "Caractères" à la Télévision (émission de Bernard Rapp) et "L'amour de la terre" , deux ouvrages qui constituent un précieux document sur le monde rural dans le Léon.
Yvonne Bonnefoi-Riou avait 19 ans en 1944. Elle se souvient des événements qui ont marqué la Libération tels qu'elle les a vécu dans l'exploitation où elle travaillait : " Le 7 août 1944, je suis montée en compagnie de mes deux frères sur un tas de paille, car nous venions d'entendre un bruit anormal. C'était les chars américains. Un lieutenant qui se tenait dans le premier tank a sorti un drapeau blanc, il est allé demander aux Allemands qui étaient depuis plusieurs années au bord de l'étang, de se rendre. L'officier américain a été tué aussitôt ".
Un géant allemand poseur de mines :
Yvonne poursuit son récit : " D'où nous étions, nous apercevions des baraques en feu. Nous sommes descendus sur la route avec des sceaux de lait pour abreuver à volonté les premiers fantassins qui braquaient leurs fusils en direction des talus. A 15 h deux Allemands qui sortaient du souterrain ont été abattus par les GI's ".
" Dans la soirée j'ai vu faire un prisonnier, puis un tank américain enlisé dans notre prairie a été détruit pour le soustraire à l'ennemi. Le lendemai, les soldats US se sont repliés vers Lesneven, laissant la garde du carrefour des Trois Curés aux hommes dela Résistance. Ces derniers par une nuit de clair de lune, entendirent des pas et virent une immense silhouette casquée déboucher d'un chemin creux. Ils firent feu et abattirent le géant qui portait une mine afin de la placer au croisement ".
" Ensuite, le carrefour resta sans garde. Notre patronne alla en chaussons voir ses betteraves au coin du champ. Six ou sept Allemands y dormaient.Son frère prit son vélo pour avertir les résistants à Bourg-Blanc. Ils arrivèrent en camion, qu'ils laissèrent à bonne distance et s'approchèrent silencieusement avant d'ouvrir le feu. Deux soldats allemands furent abattus. Les autres s'enfuirent à travers la campagne vers Gouesnou ".
Une centaine de GI's à la ferme :
Quelques jours plus tard, Yvonne et les siens virent passer un convoi qu'elle évalua à trois mille Allemands battre en retraite vers Brest.
" Après cela, les Américains se sont installés dans nos champs. Ils ont creusé des trous énormes, dissimulant trois canons de très gros calibres recouverts d'arbustes et de branchages. Deux mitrailleuses anti-aériennes étaient placées prés de nos bâtiments. Lorsque les obus partaient, nos toits se soulevaient et redescendaient à la même place. La peur nous tenaillait…
… Peu de temps avant la reddition de Brest, je me rappelle que mon beau-père, âgé de 76 ans, parti chercher ses chevaux, fut encerclé par treize allemands cachés derrière un bosquet. Comme il parlait trop fort, un soldat le frappa d'un coup de crosse. Il leur dit : "Vous n'allez quand même tuer un vieux comme moi. J'ai mes enfants prisonniers chez vous ". Deux heures après , ils l'ont relâché…
…Après le 18 septembre, les américains restèrent réviser leur matériel. Ils venaient du Massachussetts et du Michigan. C'est peut être eux qui ont libéré mon fiancé prisonnier depuis le début de la guerre. Il n'est revenu que le 23 mai 1945, comme tant d'autres prisonniers " .
Logico- Major

- Nombre de messages : 113
Age : 99
Date d'inscription : 31/07/2006
 La Libération de Brest
La Libération de Brest
Sous les obus, la vie :
Le 7 août 1944, après quatre ans d'occupation allemande, les Brestois sont confirmés dans leurs espoirs… comme dans leurs craintes. L'Etat de Siège est proclamé, les Américains sont aux portes de Brest. Pendant cinq semaines, la population va vivre sous un déluge ininterrompu d'obus et assister quasiment impuissante à la destruction de la ville. Beaucoup ont du partir. Certains sont restés jusqu'au bout.
Depuis le débarquement en Normandie, tout le monde attend la délivrance. Dans l'ensemble, les Brestois sont convaincus que le siège de la ville sera très court. Il faudra malheureusement cinq semaines pour que le cauchemar prenne fin.
L'évacuation générale :
Le lundi 7 août, jour de la proclamation de l'état de siège, la loi martiale est établie. Désormais, il sera interdit d'ouvrir les fenêtres et de se pencher au dehors. Certains l'apprendront à leurs dépens.
Devant l'attitude suicidaire du tristement célèbre général Ramcke (il résistera jusqu'à la fin en commettant les pires excès), Mr Eusen, président de la délégation spéciale de Brest, décide de procéder à l'évacuation générale de la ville, sous couvert d'une trêve qu'il a obtenu.
Nous sommes le 13 août. L'exode commence pour 23 000 Brestois (ils étaient 120 000 avant la guerre). L'évacuation se fait dans deux directions ; Saint-Renan et Châteaulin. Toute la journée, les communes des alentours voient arriver des cortèges de Brestois harassés. Ils laissent derrière eux leurs maisons et tout ce qu'ils possèdent.
Brest, ville sans Brestois ? Non, au lendemain de l'évacuation, ils sont 2 000 irréductibles bien décidés à rester jusqu'au bout. 400 personnes vont occuper l'abri Sadi-Carnot (on en connaît malheureusement la fin), 500 trouveront refuge dans les caves de l'hôpital Ponchelet. Le reste est disséminé en ville et en banlieue, à Lambézéllec notamment.
La leçon des anciens :
Paradoxalement , pendant ces derniers jours d'occupation, le couvert est assuré dans des conditions satisfaisantes. Mais au prix de quels efforts ! De véritables expéditions sont menée par ceux qui tour à tour, sont désigné pour aller aux vivres.
Les anciens – Ceux de la guerre 1914-1918 enseignent aux jeunes, les gestes de survie : Se planquer, garer la pitance et faire gaffe aux sifflements
annonciateurs de bombes.
Pendant ce temps les tâches du personnel de la ville et des volontaires de la défense passive s'intensifient. Il faut porter secours aux blessés, enterrer les morts, et dans la mesure du possible, sauver les mai-
Il faut également s'occuper des Brestois qui n'ont pas voulu partir et qui attendent la fin des combats. Certes les plus prudents se cachent dans leurs caves, tandis que d'autres restent dans les maisons, sans autre protection que l'optimisme.
Des battues sont organisées par des équipes de secours afin de leur assurer un ravitaillement minimum. Une main tendue à travers un soupirail, une toux exagérée à dessein. Plus le temps passe, plus les recherches sont facilitées par la faim et l'angoisse de ces derniers rescapés.
La vie prend le dessus, mais le siège dure. Le 23 août, la radio annonce triomphalement la Libération de Paris…
Il faudra attendre le 18 septembre pour que Brest soit enfin libérée.
Partir ou Rester :
Voici ce qu'écrit Albert Vuliez dans " Brest au combat " à propos du début du mois d'août 1944 : " Au nord, le quartier Saint-Martin et la partie urbaine de Lambézellec, ont été en grande partie évacués. Les dévastations y sont considérables et chacun se rencontre que c'est par là que les Américains vont rentrer ".
Il ajoute : " Par contre, dans la partie rurale de Lambézellec qui s'étend jusqu'à Bohars et Guipavas et qui ne comprend guère que des fermes et des villas, les ordres pressants du maire Kervern n'ont pas été exécutés… ".
La preuve, les extraits du journal de Jeanne M.
Durant les semaines qui précédèrent l'évacuation, puis le siège de Brest, une ménagère eut l'idée de tenir un journal, alors que les préoccupation de sécurité ou de ravitaillement occupaient son esprit. Un récit de la vie quotidienne, appartenant certes à la petite histoire, mais assez significatif de l'ambiance qui pouvait règner les derniers jours. L'auteur du document présenté ici habitait à Lambézellec.
Des Nerfs surexcités :
6 août : " L'état de siège est déclaré. Les gens ne peuvent circuler librement que jusqu'à 15 h : Grand émoi évidemment. Impossible pour moi de regagner Coat-Meal, d'ailleurs je n'en ai nulle envie. Mais malgré tout, cela fait un effet surprenant de voir différentes personnes qui devaient rester, s'en aller comme des lapins. La décision de rester est donc prise. Il est convenu qu'à la moindre alerte, nous nous réfugions dans la tranchée de Mme G. ".
7 août : " Toujours la même vie, les nerfs sont surexcités. Nous vivons dans une angoisse sans nom. Le danger est imminent, et malgré tout, nous ne tenons pas à partir, même si la défense passive nous y invite. Le commandant de la place indique que la circulation sera libre de 9 h à 11 h et qu'aucune formalité ne sera exigée jusqu'à la suspension de l'état de siège ".
" Il est à peine 9 h et tout le monde est debout. Les laitiers circulent, les commerces ouvrent leur porte, et chacun s'approvisionne tant bien que mal. On distribue le sucre de juillet au grand contentement des ménagères qui persistent à rester sur les lieux ".
7 août (soir) : " Eugêne arrive à la maison. Il nous apprend que l'arsenal est laissé libre, que l'amiral risque d'être fusillé pour ne pas avoir obéi aux ordres Allemands… Plusieurs osent dire que les Américains sont encore à 80 km. On dit aussi qu'ils arrivent par la route de Taulé"
" Le canon gronde, les avions survolent la ville. Il nous faut regagner nos abris à chaque instant… A part cela, tout est calme. La vie mouvementée se passe du côté des jardins. Et c'est là que l'on peut échanger nos impressions. On se pose les questions : Vous partez ? Vous restez ? Nous allons de l'un à l'autre cherchant toujours à se raccrocher à une idée qui serait la bonne ".
Seul salut, la tranchée :
8 août : " Toujours alerte sur alerte. Ce soir bombardement intense de l'aviation. Un avion est touché. Nous assistons à ce spectacle. Nous voyons le pilote descendre en parachute. Ce soir là Mme Q. essaie de gagner la route de Gouesnou. Les G. font de même, mais eux par la route de Penfeld. Ils reviennent navrés de n'avoir pu passer. Les Allemands leur disaient : " Egal, vous Kaput ".
" Il faut comprendre, que d'un côté comme de l'autre, le danger est le même. Les Américains sont à Beg-Avel, en Bourg-Blanc. On ne peut croire qu'ils soient si prés. Cependant M.C. passant par chez nous, me confirme que oui, qu'un copain à lui les a vus et qu'ils ont joué aux cartes ensembles ".
9 août : " L'auto de la défense passive dit que l'on peut partir par Coat-Méal. Hélas, pas plus là qu'ailleurs. Partout sur les routes, il y a du danger. Les avions laissent tomber une pluie de tracts. Rédigés en Allemand, ils incitent les occupants à se rendre prisonniers ".
" Ceux ci veulent tenir jusqu'au bout et ripostent immédiatement. Par moment, on perd confiance, notre seule planche de salut est la tranchée. Combien de temps nous abritera-t-elle des bombes ? ".
11 août : " J'apprends que la boucherie est ouverte. Il y a une queue formidable ! Cela veut dire que beaucoup de gens sont encore là. Il est 10 h 45 , on ne peut plus circuler. Le canon gronde de plus en plus. Pas de doute, les Américains approchent, car les obus pleuvent, et les Allemands ripostent. On apprend que la ville de Gouesnou a été évacuée et qu'il y a plusieurs morts ".
13 août : " Les américains sont sur la route de Guipavas et à la hauteur de Lilizac. Nous avons assisté à la messe de Lambézellec car c'est la fête de Saint-Laurent. Je suis étonnée e voir tant de monde à l'église. Tout le monde n'est pas parti à la campagne. Il y a des enfants et même des bébés, ce qui n'est guère prudent. Journée relativement calme. Nous avons pu dormir un peu, sans se donner la peine de se déshabiller évidemment. L'auto de défense passive est venue. Que faire ? Partir ? Rester ? Il doit y avoir grand danger ".
Il faut partir :
14 août : " Nous apprenons que les Brestois se décident à partir. On ne leur donne que deux heures pour cela. A Lambézellec, nous croyons qu'il nous sera fait exception. Hélas, l'auto repasse et cette fois c'est pour tout le monde ".
" Grand désarroi dans le quartier. Ca nous ennuie de partir. On dit que partout où les gens sont partis, on pille,et les bêtes sont laissées à l'abandon ".
" Il est 10 h , pas un seul coup de canon. Nous décidons qu'il vaut mieux s'en aller ".
14 août (midi) après: " L'heure es grave, il faut partir. Toute la population est évacuée.Il fait une chaleur terrible. Nous devons être à Saint-Renan à 20 h . Toutes les maisons se ferment. Tout le monde est prêt et nous allons grossir la caravane. A la volonté de Dieu ".
Pendant 40 jours, Mme M. vivra à Tréomp
19 septembre : " Nous avons retrouvé par bonheur notre maison intacte. Elle a été remuée de fond en comble, mais le pillage est insignifiant. Notre église de Lambézellec n'existe plus, ainsi que bon nombre de maisons de la place ".
BREST CONQUIS
Sous les bombes pour sauver les blessés :
Défense Passive : Curieux nom pour ceux qui ont agi sans relâche pendant toute la guerre au service de la population. " Nous avons fait ce que notre devoir nous commandait " aime à dire Alexis Corre, médecin-chef de la Défense passive et qui eut la charge au début du siège, d'organiser les postes de secours dans les différents quartiers de Brest. Dans les postes de la rive droite, une infirmière, Melle Galand, est restée elle aussi, jusqu'à la fin du siège.
La défense passive était composée de Brestois requis par la préfecture de Quimper, pour porter assistance aux personnes en péril durant les bombardements. Il s'agissait notamment de personnel médical, mais aussi de manoeuvres pour le déblaiement..
Sous un déluge de bombes, dans les incendies et l'insécurité, face à une armée allemande à bout, les membres de la défense passive ont continué à sauver des vies.
63 morts dans leurs rangs :
" Sitôt l'alerte terminée, et parfois même avant, on courait vers les immeubles éventrés. La recherche des victimes sous les ruines se faisait à la main. " Les grands blessés étaient évacués vers l'hôpital maritime " raconte Melle Galand.
La défense passive gérait de nombreux abris souterrains à Brest. Le plus important de la rive droite était situé sous la mairie des "Quatre Moulins", un autre se trouvait sous l'église de Kerbonne. Pour être sûrs, les abris devaient se trouver entre six et dix-huit mètres de profondeur. Les membres de la défense passive à Brest ont payé un lourd tribut. Pas moins de soixante-trois d'entre eux ont trouvé la mort. Triste record, puisqu'ils ne furent que vingt-neuf tués à Paris et quatorze à Caen.
Chassés de leurs abris :
Les heures les plus dures furent sans conteste celles du siège. "Le ravitaillement n'arrivait plus. Nous avons prélevé de la viande sur un cheval mort. Les Allemands devenaient de plus en plus nerveux, persuadés que nous informions les alliés par radio, ils ont fouillé l'abri sans succès et nous ont finalement relâchés".
Chassés de l'abri par les Allemands, Melle Galand et les docteurs Lucas et Romé trouve refuge dans une cave de la rue Anatole France, qui restera leur abri jusqu'à l'arrivée des Américains dans cette rue le 17 septembre : " Ils étaient étonnés de voir des civils vivants au milieu de toutes ces ruines ".
La notion de jour et de nuit s'estompait pour les membres de la défense passive restés dans Brest. A partir du poste de secours qu'il avait créé au 47 rue Victor Hugo, tandis qu'il habitait au 54 de cette même rue, le docteur Alexis Corre allait chaque jour, sous les obus et les bombes visiter les autres postes de secours.
Le 7 août 1944, après quatre ans d'occupation allemande, les Brestois sont confirmés dans leurs espoirs… comme dans leurs craintes. L'Etat de Siège est proclamé, les Américains sont aux portes de Brest. Pendant cinq semaines, la population va vivre sous un déluge ininterrompu d'obus et assister quasiment impuissante à la destruction de la ville. Beaucoup ont du partir. Certains sont restés jusqu'au bout.
Depuis le débarquement en Normandie, tout le monde attend la délivrance. Dans l'ensemble, les Brestois sont convaincus que le siège de la ville sera très court. Il faudra malheureusement cinq semaines pour que le cauchemar prenne fin.
L'évacuation générale :
Le lundi 7 août, jour de la proclamation de l'état de siège, la loi martiale est établie. Désormais, il sera interdit d'ouvrir les fenêtres et de se pencher au dehors. Certains l'apprendront à leurs dépens.
Devant l'attitude suicidaire du tristement célèbre général Ramcke (il résistera jusqu'à la fin en commettant les pires excès), Mr Eusen, président de la délégation spéciale de Brest, décide de procéder à l'évacuation générale de la ville, sous couvert d'une trêve qu'il a obtenu.
Nous sommes le 13 août. L'exode commence pour 23 000 Brestois (ils étaient 120 000 avant la guerre). L'évacuation se fait dans deux directions ; Saint-Renan et Châteaulin. Toute la journée, les communes des alentours voient arriver des cortèges de Brestois harassés. Ils laissent derrière eux leurs maisons et tout ce qu'ils possèdent.
Brest, ville sans Brestois ? Non, au lendemain de l'évacuation, ils sont 2 000 irréductibles bien décidés à rester jusqu'au bout. 400 personnes vont occuper l'abri Sadi-Carnot (on en connaît malheureusement la fin), 500 trouveront refuge dans les caves de l'hôpital Ponchelet. Le reste est disséminé en ville et en banlieue, à Lambézéllec notamment.
La leçon des anciens :
Paradoxalement , pendant ces derniers jours d'occupation, le couvert est assuré dans des conditions satisfaisantes. Mais au prix de quels efforts ! De véritables expéditions sont menée par ceux qui tour à tour, sont désigné pour aller aux vivres.
Les anciens – Ceux de la guerre 1914-1918 enseignent aux jeunes, les gestes de survie : Se planquer, garer la pitance et faire gaffe aux sifflements
annonciateurs de bombes.
Pendant ce temps les tâches du personnel de la ville et des volontaires de la défense passive s'intensifient. Il faut porter secours aux blessés, enterrer les morts, et dans la mesure du possible, sauver les mai-
Il faut également s'occuper des Brestois qui n'ont pas voulu partir et qui attendent la fin des combats. Certes les plus prudents se cachent dans leurs caves, tandis que d'autres restent dans les maisons, sans autre protection que l'optimisme.
Des battues sont organisées par des équipes de secours afin de leur assurer un ravitaillement minimum. Une main tendue à travers un soupirail, une toux exagérée à dessein. Plus le temps passe, plus les recherches sont facilitées par la faim et l'angoisse de ces derniers rescapés.
La vie prend le dessus, mais le siège dure. Le 23 août, la radio annonce triomphalement la Libération de Paris…
Il faudra attendre le 18 septembre pour que Brest soit enfin libérée.
Partir ou Rester :
Voici ce qu'écrit Albert Vuliez dans " Brest au combat " à propos du début du mois d'août 1944 : " Au nord, le quartier Saint-Martin et la partie urbaine de Lambézellec, ont été en grande partie évacués. Les dévastations y sont considérables et chacun se rencontre que c'est par là que les Américains vont rentrer ".
Il ajoute : " Par contre, dans la partie rurale de Lambézellec qui s'étend jusqu'à Bohars et Guipavas et qui ne comprend guère que des fermes et des villas, les ordres pressants du maire Kervern n'ont pas été exécutés… ".
La preuve, les extraits du journal de Jeanne M.
Durant les semaines qui précédèrent l'évacuation, puis le siège de Brest, une ménagère eut l'idée de tenir un journal, alors que les préoccupation de sécurité ou de ravitaillement occupaient son esprit. Un récit de la vie quotidienne, appartenant certes à la petite histoire, mais assez significatif de l'ambiance qui pouvait règner les derniers jours. L'auteur du document présenté ici habitait à Lambézellec.
Des Nerfs surexcités :
6 août : " L'état de siège est déclaré. Les gens ne peuvent circuler librement que jusqu'à 15 h : Grand émoi évidemment. Impossible pour moi de regagner Coat-Meal, d'ailleurs je n'en ai nulle envie. Mais malgré tout, cela fait un effet surprenant de voir différentes personnes qui devaient rester, s'en aller comme des lapins. La décision de rester est donc prise. Il est convenu qu'à la moindre alerte, nous nous réfugions dans la tranchée de Mme G. ".
7 août : " Toujours la même vie, les nerfs sont surexcités. Nous vivons dans une angoisse sans nom. Le danger est imminent, et malgré tout, nous ne tenons pas à partir, même si la défense passive nous y invite. Le commandant de la place indique que la circulation sera libre de 9 h à 11 h et qu'aucune formalité ne sera exigée jusqu'à la suspension de l'état de siège ".
" Il est à peine 9 h et tout le monde est debout. Les laitiers circulent, les commerces ouvrent leur porte, et chacun s'approvisionne tant bien que mal. On distribue le sucre de juillet au grand contentement des ménagères qui persistent à rester sur les lieux ".
7 août (soir) : " Eugêne arrive à la maison. Il nous apprend que l'arsenal est laissé libre, que l'amiral risque d'être fusillé pour ne pas avoir obéi aux ordres Allemands… Plusieurs osent dire que les Américains sont encore à 80 km. On dit aussi qu'ils arrivent par la route de Taulé"
" Le canon gronde, les avions survolent la ville. Il nous faut regagner nos abris à chaque instant… A part cela, tout est calme. La vie mouvementée se passe du côté des jardins. Et c'est là que l'on peut échanger nos impressions. On se pose les questions : Vous partez ? Vous restez ? Nous allons de l'un à l'autre cherchant toujours à se raccrocher à une idée qui serait la bonne ".
Seul salut, la tranchée :
8 août : " Toujours alerte sur alerte. Ce soir bombardement intense de l'aviation. Un avion est touché. Nous assistons à ce spectacle. Nous voyons le pilote descendre en parachute. Ce soir là Mme Q. essaie de gagner la route de Gouesnou. Les G. font de même, mais eux par la route de Penfeld. Ils reviennent navrés de n'avoir pu passer. Les Allemands leur disaient : " Egal, vous Kaput ".
" Il faut comprendre, que d'un côté comme de l'autre, le danger est le même. Les Américains sont à Beg-Avel, en Bourg-Blanc. On ne peut croire qu'ils soient si prés. Cependant M.C. passant par chez nous, me confirme que oui, qu'un copain à lui les a vus et qu'ils ont joué aux cartes ensembles ".
9 août : " L'auto de la défense passive dit que l'on peut partir par Coat-Méal. Hélas, pas plus là qu'ailleurs. Partout sur les routes, il y a du danger. Les avions laissent tomber une pluie de tracts. Rédigés en Allemand, ils incitent les occupants à se rendre prisonniers ".
" Ceux ci veulent tenir jusqu'au bout et ripostent immédiatement. Par moment, on perd confiance, notre seule planche de salut est la tranchée. Combien de temps nous abritera-t-elle des bombes ? ".
11 août : " J'apprends que la boucherie est ouverte. Il y a une queue formidable ! Cela veut dire que beaucoup de gens sont encore là. Il est 10 h 45 , on ne peut plus circuler. Le canon gronde de plus en plus. Pas de doute, les Américains approchent, car les obus pleuvent, et les Allemands ripostent. On apprend que la ville de Gouesnou a été évacuée et qu'il y a plusieurs morts ".
13 août : " Les américains sont sur la route de Guipavas et à la hauteur de Lilizac. Nous avons assisté à la messe de Lambézellec car c'est la fête de Saint-Laurent. Je suis étonnée e voir tant de monde à l'église. Tout le monde n'est pas parti à la campagne. Il y a des enfants et même des bébés, ce qui n'est guère prudent. Journée relativement calme. Nous avons pu dormir un peu, sans se donner la peine de se déshabiller évidemment. L'auto de défense passive est venue. Que faire ? Partir ? Rester ? Il doit y avoir grand danger ".
Il faut partir :
14 août : " Nous apprenons que les Brestois se décident à partir. On ne leur donne que deux heures pour cela. A Lambézellec, nous croyons qu'il nous sera fait exception. Hélas, l'auto repasse et cette fois c'est pour tout le monde ".
" Grand désarroi dans le quartier. Ca nous ennuie de partir. On dit que partout où les gens sont partis, on pille,et les bêtes sont laissées à l'abandon ".
" Il est 10 h , pas un seul coup de canon. Nous décidons qu'il vaut mieux s'en aller ".
14 août (midi) après: " L'heure es grave, il faut partir. Toute la population est évacuée.Il fait une chaleur terrible. Nous devons être à Saint-Renan à 20 h . Toutes les maisons se ferment. Tout le monde est prêt et nous allons grossir la caravane. A la volonté de Dieu ".
Pendant 40 jours, Mme M. vivra à Tréomp
19 septembre : " Nous avons retrouvé par bonheur notre maison intacte. Elle a été remuée de fond en comble, mais le pillage est insignifiant. Notre église de Lambézellec n'existe plus, ainsi que bon nombre de maisons de la place ".
BREST CONQUIS
Sous les bombes pour sauver les blessés :
Défense Passive : Curieux nom pour ceux qui ont agi sans relâche pendant toute la guerre au service de la population. " Nous avons fait ce que notre devoir nous commandait " aime à dire Alexis Corre, médecin-chef de la Défense passive et qui eut la charge au début du siège, d'organiser les postes de secours dans les différents quartiers de Brest. Dans les postes de la rive droite, une infirmière, Melle Galand, est restée elle aussi, jusqu'à la fin du siège.
La défense passive était composée de Brestois requis par la préfecture de Quimper, pour porter assistance aux personnes en péril durant les bombardements. Il s'agissait notamment de personnel médical, mais aussi de manoeuvres pour le déblaiement..
Sous un déluge de bombes, dans les incendies et l'insécurité, face à une armée allemande à bout, les membres de la défense passive ont continué à sauver des vies.
63 morts dans leurs rangs :
" Sitôt l'alerte terminée, et parfois même avant, on courait vers les immeubles éventrés. La recherche des victimes sous les ruines se faisait à la main. " Les grands blessés étaient évacués vers l'hôpital maritime " raconte Melle Galand.
La défense passive gérait de nombreux abris souterrains à Brest. Le plus important de la rive droite était situé sous la mairie des "Quatre Moulins", un autre se trouvait sous l'église de Kerbonne. Pour être sûrs, les abris devaient se trouver entre six et dix-huit mètres de profondeur. Les membres de la défense passive à Brest ont payé un lourd tribut. Pas moins de soixante-trois d'entre eux ont trouvé la mort. Triste record, puisqu'ils ne furent que vingt-neuf tués à Paris et quatorze à Caen.
Chassés de leurs abris :
Les heures les plus dures furent sans conteste celles du siège. "Le ravitaillement n'arrivait plus. Nous avons prélevé de la viande sur un cheval mort. Les Allemands devenaient de plus en plus nerveux, persuadés que nous informions les alliés par radio, ils ont fouillé l'abri sans succès et nous ont finalement relâchés".
Chassés de l'abri par les Allemands, Melle Galand et les docteurs Lucas et Romé trouve refuge dans une cave de la rue Anatole France, qui restera leur abri jusqu'à l'arrivée des Américains dans cette rue le 17 septembre : " Ils étaient étonnés de voir des civils vivants au milieu de toutes ces ruines ".
La notion de jour et de nuit s'estompait pour les membres de la défense passive restés dans Brest. A partir du poste de secours qu'il avait créé au 47 rue Victor Hugo, tandis qu'il habitait au 54 de cette même rue, le docteur Alexis Corre allait chaque jour, sous les obus et les bombes visiter les autres postes de secours.
Logico- Major

- Nombre de messages : 113
Age : 99
Date d'inscription : 31/07/2006
 La Libération de Brest
La Libération de Brest
Un déferlement de 3 000 avions :
Là aussi, les vivres manquaient, et il fallait chaque jour accomplir la corvée d'eau. " Nous allions chercher l'eau à la fontaine de Kerjean-Vras. Mais la lessiveuse était quasiment vide à notre arrivée à force de nous jeter à plat ventre pour nous protéger des bombardements. Avec mon ami, le pharmacien Léon Guiard, nous sommes restés une fois quatre heures à terre sans pouvoir bouger dans les "Glacis". C'était à l'emplacement de l'actuelle Place de la Liberté, lors du déferlement des avions anglais au début du mois de septembre. On en compta plus de 3 000 en une seule après midi ".
Les derniers jours du siège furent terribles pour le Docteur Corre, rongé par l'inquiétude lorsqu'il s'aperçut que le clocher de Plougastel avait disparu. La maison qui abritait sa femme et son fils se trouvait juste en dessous, et il pensait qu'ils avaient péri. Ce n'est qu'à la fin des combats qu'il put rejoindre Plougastel et être rassuré. Sa famille avait rejoint Quimper la veille du bombardement. " Un véritable miracle, une bombe était tombée dans ma chambre, et le berceau de mon fils avait été retrouvé dans un jardin ".
Un Allemand Kidnappé au nom de la Croix Rouge :
Mais la vie durant le siège, laisse aussi quelques anecdotes moins sombres. Ainsi, le docteur Corre a toujours conservé le billet de 500 francs, que lui avait remis en guise de maigre compensation, un soldat qui avait jeté son dévolu sur le matériel de petite chirurgie du médecin-chef de la défense passive.
Mieux, le Docteur Corre et Léon Guiard ont même fait un prisonnier aux dernières heures du siège. " Un soldat allemand qui pensait avoir trouvé une cachette dans notre poste de secours de la rue Victor Hugo. Nous l'avons kidnappé, puis remis aux Américains, non sans avoir auparavant confisqué tout l'argent qu'il avait sur lui, une véritable fortune, un peu plus de 306 000 francs (258 000 F actuels ). Contre cette somme, nous lui avons donné un reçu en bonne et due forme ". Tout l'argent a été remis à la Croix Rouge Française, très exactement le 13 octobre 1944, comme l'atteste le reçu toujours conservé par le Docteur Alexis Corre.
Restaurateurs de l'Impossible :
Malgré l'occupant, les bombes, les risques, la mort, la souffrance et la solitude, il fallait bien essayer de manger pour survivre. C'est la leçon donnée par le témoignage d'André Collet.
André Collet fait partie de ces familles de Brestois qui ont payé le prix fort durant la guerre. Son frère et sa jeune sœur, infirmière sont en effet du nombre des victimes de la tragédie de l'abri de Sadi-Carnot. Une fracture sentimentale qui explique sans doute le dévouement et l'énergie qui ont été le moteur de toute son existence.
En août 1944, Dédé Collet avait 24 ans. Il faisait partie des auxiliaires de la Défense Passive (ADP) créés par Pierre Branellec avec les frères Prévosto. Ils travaillaient à la restauration du moral… par l'estomac.
Installée Place Wilson, la popotte qui possédait une succursale rue Danton, avait pour mission d'assurer l'prdinaire des Français restés seuls à Brest, principalement des hommes.
De l'anecdote à la tragédie :
" Jusqu'à notre évacuation liée à l'état de siège, nous avions la chance, du fait de notre statut, d'être un peu ravitaillé ".
" On servait du vin, parfois de la viande et quelques féculents. Le plus compliqué était d'assurer le service, car nous manquions de tout. Un jour, il nous afallu utiliser desx ventouses en guise de verres ".
A côté de ces anecdotes, ces restaurateurs de l'impossible connurent aussi le pire. " Il y avait parmi nous un acheteur nommé Léon Daniel, dit le ravitailleur. Resté à Brest intra-muros pendant l'état de siège, il est mort décapité par un éclat d'obus, alors qu'il transportait une cafetière à l'abri Sadi-Carnot ".
Obligé de quitter la ville, André Collet prend à la mi-août 1944 la direction de Kerfily à Porsmilin. Il y passe quelques jours mais revient très vite, "par curiosité". " J'avais un laisser passer. J'ai traversé le Bouguen alors qu'on entendait encore Allemands et Américains échanger des coups de feu ".
Affluence record :
Après la libération de Brest, Pierre Branellec remonte le restaurant de l'ADP prés de l'actuel Monoprix, dans es conditions matérielles encore plus difficiles qu'auparavant.
" Tout était transporté sur des plateaux montés sur des roues de voitures et tirés par des chevaux. Le plus dur était le ravitaillement en eau. Celle ci, un brin saumâtre, provenait d'un puit artésien que les Allemands avaient foré prés du château. Entre les trous d'obus, nous nous rendions jusque là en roulant d'énormes fûts ".
La cantine de la Défense Passive doit aussi faire face à une formidable affluence de clientèle. " On faisait à manger jour et nuit, surtout des patates. Les gens revenaient petit à petit voir l'état de la ville et c'est la maison qui leur fournissait des tickets de repas ", se souvient Mr Collet. Dans sa mémoire, le cocasse prend parfois le pas sur le tragique de la situation. Comme cette gouttière de bois fabriquée à la fortune du pot par un menuisier de l'arsenal, et qui empêchait l'eau de pluie d'inonder les fourneaux par les constellations d'impacts de bombes.
Plus tard, avec Charles Muzy à ses côtés, André Collet tiendra le piano du restaurant de l'Organisation Nationale pour la Reconstruction. " Nous avons commencé par les repas et l'hébergement, l'ONCOR a créé un foyer avec vente de casse-croûtes, de café, de boissons. Il fallait construire des baraques en vitesse pour répondre à la demande ".
Signe que la vie avait repris son cours.
PONCHELET. Un Hôpital à 20 mètres sous terre :
Avant la guerre, Ponchelet abritait un hospice de vieillards, mais lorsque les hospices civils furent détruits par les bombardements en 1941, Ponchelet devint un hôpital. Le Docteur Alexis Corre, médecin chef de la Défense Passive, qui avait réchappé miraculeusement de la destruction des hospices civils, se souvient encore de son arrivée au lever du jour, trois bébés dans les bras, demandant à la mère supérieure de faire évacuer les personnes âgées pour y établir le nouvel hôpital.
Le dernier bâtiment de ce qui est resté longtemps pour les Brestois "l'Hôpital Ponchelet" a été détruit en 1989 pour laisser la place à une maison de retraite moderne. Mais il reste encore un témoin de cette époque. En effet, l'abri construit en 1943 qui relie Ponchelet à la rue Pierre Sémart (ancienne Rue du Gaz) a été conservé. On y trouve quelques traces de l'activité qui y règna aux heures les plus dures de la guerre.
119 Marches :
Le docteur Max Laferre qui dirigeait la section Marine de l'hôpital Ponchelet a relaté dans son ouvrage " Le Siège de Brest " les péripéties qu'il vécut là entre le 7 août et le 18 septembre 1944. L'Hôpital devait cependant être loibéré par les Américains dés le dimanche 10 septembre.
Le service de médecins où le docteur Max Laferre donnait des consultations de Phtisiologie avait été expulsé de l'hôpital maritime par les allemands. C'est pourquoi, il s'était installé à Ponchelet sous le vocable de section marine de l'hôpital.
L'ensemble de l'abri se trouve à une profondeur de dix huit à vingt et un mètres. On y accède par un escalier de 119 marches. Mais au début du siège de Brest, l'abri n'était toujours pas achevé. Il fallut rapidement aménager la salle d'opération et équiper en lits la partie de l'abri où étaient accueillis les blessés.
L'abri envahi par les réfugiés :
Un espace avait été réservé aux civils venus se réfugier pendant les bombardements. Ces derniers furent très nombreux, du moins au début du siège, comme le souligne le docteur Laferre : " Il y eut de véritables invasions. Celles ci se produisirent dés le 10 août… Certains soirs il y eut peut être plus ee 3 000 personnes dans l'abri… Apartir du 14 août, les évacuations commencèrent à décongestionner l'abri. Je dis commencèrent car il y eut pendant plusieurs jours des irréductibles qui ne voulaient pas quitter leur maison " .
260 blessés opérés dans l'abri… et 3 naissances :
Les blessés et les réfugiés restaient quasiment en permanence dans l'abri. Le personnel de l'hôpital vaquait en surface à ses occupations entre les alertes. C'est pourquoi, il y eut trois morts et une dizaine de blessés parmi eux.
Au début du siège le personnel médical coucha en surface, mais par la suite ils aménagèrent un espace dans le souterrain.
De nombreux blessés furent opérés dans l'abri. Le docteur Laferre estime leur nombre à 260 environ, et plus de 20 % succombèrent en raison de la gravité de leurs blessures et des conditions de vie dans l'abri où l'atmosphère était humide et chaude. Parmi tous ces blessés, il y eut tout de même trois naissances, signe de la vie qui continue.
Les premiers américains atteignirent l'abri le 10 septembre au soir et le vendredi 15 septembre, leurs ambulanciers arrivèrent par la rue du Gaz, déblayée par les scrappers, pour évacuer les malades et les blessés. Une page de l'histoire souterraine de l'hôpital Ponchelet était tournée.
Un Lieu de Résistance Méconnu :
Tout en soignant, le docteur Laferre, qui vit actuellement à Antibes servait également d'agent de renseignements aux Alliés. Une activité dont il n'a pas fait état dans son livre, mais qu'il raconte aujourd'hui : " L'obligation de réserve ayant disparue, voilà l'occasion de d'évoquer le rôle clandestin de l'Hôpital Ponchelet ".
Le docteur Laferre raconte : " A la demande du docteur Jacq de Lambézellec, et de leur chef, le capitaine Bellocq, les gendarmes de Pontanézen y trouve refuge, tout au moins ceux appartenant à la Résistance, qui me sont signalés par un signe convenu. Le chef de service, le médecin de 1ère classe Nun et le premier maître infirmier Cabon, sont bien entendu dans le secret ".
" Lors de la proclamation de l'état de siège, le 7 août 1944, j'ai en charge les postes de secours de la rue de la voûte et de l'école Saint-Laurent à Lambézellec. J'y serai remplacé dans le premier par le docteur Lafolie, réactivé et qui laissera sa vie dans l'abri Sadi-Carnot et dans le second par le médecin 1ère classe Nun ".
Des Missions de Renseignements :
" En effet, le contre amiral Negadelle, demande au médecin général Hayet, sans lui en indiquer la raison, de me désigner à la tête de la Section Marine. Ceci pour me permettre d'accomplir la mission de renseignements et de liaison avec le capitaine de vaisseau Lucas, chef des unités marine, hors de Brest et l'état major Américain du général Middleton ".
" Ce sera la dernière mission que j'accomplirai, suite à celles entreprises à Brest depuis avril 1942, à l'insu du service de santé auquel j'appartenais ".
" Un poste de radio à galène est alors installé dans le grenier, et une antenne sur le toît pour capter les ordres du général Koenig, chef des FFI. Un second poste me sera fourni par un externe de l'hôpital, Mr Colin. Peu après, Mr Melix, un artisan électricien réfugié dans l'abri, met en état un poste à accus, ceux ci étant récupéré sur des voitures en stationnement à l'hôpital ".
Exécution des traîtres :
" Les documents militaires et politiques confiés par l'amiral, puis ultérieurement par son officier d'intendance, l'IGM Ravault, grièvement blessé auprès de son chef tué le 25 août 1944 sont dissimulés sous le grabat qui me sert de couche dans l'abri ".
" Pour la transmission des renseignements, et leur collecte, je serai aidé par le maître gendarme léger Bourdon, agent de renseignements, par sept officiers mariniers de l'unité marine mis à mes ordres, dont le maître Jardin, qui fut sévèrement touché ".
" L'aide la plus importante me fut apportée par le capitaine Berger ( Marc dans la Résistance ) commandant la compagnie Marcel Boucher ( composée presque entièrement de cheminots ), seule unité restée à l'intérieur de Brest. Cinq de ses rangs, étaient affectés à ma protection, dont Georges ( je tais son nom ) qui nous servit à l'exécution des traîtres. Grâce à leur chef, par la cantine des chemins de fer, reliée au réseau SNCF, que les Allemands avaient oublié de détruire le long des lignes, je fus en liaison presque constante avec l'extérieur libéré"
Là aussi, les vivres manquaient, et il fallait chaque jour accomplir la corvée d'eau. " Nous allions chercher l'eau à la fontaine de Kerjean-Vras. Mais la lessiveuse était quasiment vide à notre arrivée à force de nous jeter à plat ventre pour nous protéger des bombardements. Avec mon ami, le pharmacien Léon Guiard, nous sommes restés une fois quatre heures à terre sans pouvoir bouger dans les "Glacis". C'était à l'emplacement de l'actuelle Place de la Liberté, lors du déferlement des avions anglais au début du mois de septembre. On en compta plus de 3 000 en une seule après midi ".
Les derniers jours du siège furent terribles pour le Docteur Corre, rongé par l'inquiétude lorsqu'il s'aperçut que le clocher de Plougastel avait disparu. La maison qui abritait sa femme et son fils se trouvait juste en dessous, et il pensait qu'ils avaient péri. Ce n'est qu'à la fin des combats qu'il put rejoindre Plougastel et être rassuré. Sa famille avait rejoint Quimper la veille du bombardement. " Un véritable miracle, une bombe était tombée dans ma chambre, et le berceau de mon fils avait été retrouvé dans un jardin ".
Un Allemand Kidnappé au nom de la Croix Rouge :
Mais la vie durant le siège, laisse aussi quelques anecdotes moins sombres. Ainsi, le docteur Corre a toujours conservé le billet de 500 francs, que lui avait remis en guise de maigre compensation, un soldat qui avait jeté son dévolu sur le matériel de petite chirurgie du médecin-chef de la défense passive.
Mieux, le Docteur Corre et Léon Guiard ont même fait un prisonnier aux dernières heures du siège. " Un soldat allemand qui pensait avoir trouvé une cachette dans notre poste de secours de la rue Victor Hugo. Nous l'avons kidnappé, puis remis aux Américains, non sans avoir auparavant confisqué tout l'argent qu'il avait sur lui, une véritable fortune, un peu plus de 306 000 francs (258 000 F actuels ). Contre cette somme, nous lui avons donné un reçu en bonne et due forme ". Tout l'argent a été remis à la Croix Rouge Française, très exactement le 13 octobre 1944, comme l'atteste le reçu toujours conservé par le Docteur Alexis Corre.
Restaurateurs de l'Impossible :
Malgré l'occupant, les bombes, les risques, la mort, la souffrance et la solitude, il fallait bien essayer de manger pour survivre. C'est la leçon donnée par le témoignage d'André Collet.
André Collet fait partie de ces familles de Brestois qui ont payé le prix fort durant la guerre. Son frère et sa jeune sœur, infirmière sont en effet du nombre des victimes de la tragédie de l'abri de Sadi-Carnot. Une fracture sentimentale qui explique sans doute le dévouement et l'énergie qui ont été le moteur de toute son existence.
En août 1944, Dédé Collet avait 24 ans. Il faisait partie des auxiliaires de la Défense Passive (ADP) créés par Pierre Branellec avec les frères Prévosto. Ils travaillaient à la restauration du moral… par l'estomac.
Installée Place Wilson, la popotte qui possédait une succursale rue Danton, avait pour mission d'assurer l'prdinaire des Français restés seuls à Brest, principalement des hommes.
De l'anecdote à la tragédie :
" Jusqu'à notre évacuation liée à l'état de siège, nous avions la chance, du fait de notre statut, d'être un peu ravitaillé ".
" On servait du vin, parfois de la viande et quelques féculents. Le plus compliqué était d'assurer le service, car nous manquions de tout. Un jour, il nous afallu utiliser desx ventouses en guise de verres ".
A côté de ces anecdotes, ces restaurateurs de l'impossible connurent aussi le pire. " Il y avait parmi nous un acheteur nommé Léon Daniel, dit le ravitailleur. Resté à Brest intra-muros pendant l'état de siège, il est mort décapité par un éclat d'obus, alors qu'il transportait une cafetière à l'abri Sadi-Carnot ".
Obligé de quitter la ville, André Collet prend à la mi-août 1944 la direction de Kerfily à Porsmilin. Il y passe quelques jours mais revient très vite, "par curiosité". " J'avais un laisser passer. J'ai traversé le Bouguen alors qu'on entendait encore Allemands et Américains échanger des coups de feu ".
Affluence record :
Après la libération de Brest, Pierre Branellec remonte le restaurant de l'ADP prés de l'actuel Monoprix, dans es conditions matérielles encore plus difficiles qu'auparavant.
" Tout était transporté sur des plateaux montés sur des roues de voitures et tirés par des chevaux. Le plus dur était le ravitaillement en eau. Celle ci, un brin saumâtre, provenait d'un puit artésien que les Allemands avaient foré prés du château. Entre les trous d'obus, nous nous rendions jusque là en roulant d'énormes fûts ".
La cantine de la Défense Passive doit aussi faire face à une formidable affluence de clientèle. " On faisait à manger jour et nuit, surtout des patates. Les gens revenaient petit à petit voir l'état de la ville et c'est la maison qui leur fournissait des tickets de repas ", se souvient Mr Collet. Dans sa mémoire, le cocasse prend parfois le pas sur le tragique de la situation. Comme cette gouttière de bois fabriquée à la fortune du pot par un menuisier de l'arsenal, et qui empêchait l'eau de pluie d'inonder les fourneaux par les constellations d'impacts de bombes.
Plus tard, avec Charles Muzy à ses côtés, André Collet tiendra le piano du restaurant de l'Organisation Nationale pour la Reconstruction. " Nous avons commencé par les repas et l'hébergement, l'ONCOR a créé un foyer avec vente de casse-croûtes, de café, de boissons. Il fallait construire des baraques en vitesse pour répondre à la demande ".
Signe que la vie avait repris son cours.
PONCHELET. Un Hôpital à 20 mètres sous terre :
Avant la guerre, Ponchelet abritait un hospice de vieillards, mais lorsque les hospices civils furent détruits par les bombardements en 1941, Ponchelet devint un hôpital. Le Docteur Alexis Corre, médecin chef de la Défense Passive, qui avait réchappé miraculeusement de la destruction des hospices civils, se souvient encore de son arrivée au lever du jour, trois bébés dans les bras, demandant à la mère supérieure de faire évacuer les personnes âgées pour y établir le nouvel hôpital.
Le dernier bâtiment de ce qui est resté longtemps pour les Brestois "l'Hôpital Ponchelet" a été détruit en 1989 pour laisser la place à une maison de retraite moderne. Mais il reste encore un témoin de cette époque. En effet, l'abri construit en 1943 qui relie Ponchelet à la rue Pierre Sémart (ancienne Rue du Gaz) a été conservé. On y trouve quelques traces de l'activité qui y règna aux heures les plus dures de la guerre.
119 Marches :
Le docteur Max Laferre qui dirigeait la section Marine de l'hôpital Ponchelet a relaté dans son ouvrage " Le Siège de Brest " les péripéties qu'il vécut là entre le 7 août et le 18 septembre 1944. L'Hôpital devait cependant être loibéré par les Américains dés le dimanche 10 septembre.
Le service de médecins où le docteur Max Laferre donnait des consultations de Phtisiologie avait été expulsé de l'hôpital maritime par les allemands. C'est pourquoi, il s'était installé à Ponchelet sous le vocable de section marine de l'hôpital.
L'ensemble de l'abri se trouve à une profondeur de dix huit à vingt et un mètres. On y accède par un escalier de 119 marches. Mais au début du siège de Brest, l'abri n'était toujours pas achevé. Il fallut rapidement aménager la salle d'opération et équiper en lits la partie de l'abri où étaient accueillis les blessés.
L'abri envahi par les réfugiés :
Un espace avait été réservé aux civils venus se réfugier pendant les bombardements. Ces derniers furent très nombreux, du moins au début du siège, comme le souligne le docteur Laferre : " Il y eut de véritables invasions. Celles ci se produisirent dés le 10 août… Certains soirs il y eut peut être plus ee 3 000 personnes dans l'abri… Apartir du 14 août, les évacuations commencèrent à décongestionner l'abri. Je dis commencèrent car il y eut pendant plusieurs jours des irréductibles qui ne voulaient pas quitter leur maison " .
260 blessés opérés dans l'abri… et 3 naissances :
Les blessés et les réfugiés restaient quasiment en permanence dans l'abri. Le personnel de l'hôpital vaquait en surface à ses occupations entre les alertes. C'est pourquoi, il y eut trois morts et une dizaine de blessés parmi eux.
Au début du siège le personnel médical coucha en surface, mais par la suite ils aménagèrent un espace dans le souterrain.
De nombreux blessés furent opérés dans l'abri. Le docteur Laferre estime leur nombre à 260 environ, et plus de 20 % succombèrent en raison de la gravité de leurs blessures et des conditions de vie dans l'abri où l'atmosphère était humide et chaude. Parmi tous ces blessés, il y eut tout de même trois naissances, signe de la vie qui continue.
Les premiers américains atteignirent l'abri le 10 septembre au soir et le vendredi 15 septembre, leurs ambulanciers arrivèrent par la rue du Gaz, déblayée par les scrappers, pour évacuer les malades et les blessés. Une page de l'histoire souterraine de l'hôpital Ponchelet était tournée.
Un Lieu de Résistance Méconnu :
Tout en soignant, le docteur Laferre, qui vit actuellement à Antibes servait également d'agent de renseignements aux Alliés. Une activité dont il n'a pas fait état dans son livre, mais qu'il raconte aujourd'hui : " L'obligation de réserve ayant disparue, voilà l'occasion de d'évoquer le rôle clandestin de l'Hôpital Ponchelet ".
Le docteur Laferre raconte : " A la demande du docteur Jacq de Lambézellec, et de leur chef, le capitaine Bellocq, les gendarmes de Pontanézen y trouve refuge, tout au moins ceux appartenant à la Résistance, qui me sont signalés par un signe convenu. Le chef de service, le médecin de 1ère classe Nun et le premier maître infirmier Cabon, sont bien entendu dans le secret ".
" Lors de la proclamation de l'état de siège, le 7 août 1944, j'ai en charge les postes de secours de la rue de la voûte et de l'école Saint-Laurent à Lambézellec. J'y serai remplacé dans le premier par le docteur Lafolie, réactivé et qui laissera sa vie dans l'abri Sadi-Carnot et dans le second par le médecin 1ère classe Nun ".
Des Missions de Renseignements :
" En effet, le contre amiral Negadelle, demande au médecin général Hayet, sans lui en indiquer la raison, de me désigner à la tête de la Section Marine. Ceci pour me permettre d'accomplir la mission de renseignements et de liaison avec le capitaine de vaisseau Lucas, chef des unités marine, hors de Brest et l'état major Américain du général Middleton ".
" Ce sera la dernière mission que j'accomplirai, suite à celles entreprises à Brest depuis avril 1942, à l'insu du service de santé auquel j'appartenais ".
" Un poste de radio à galène est alors installé dans le grenier, et une antenne sur le toît pour capter les ordres du général Koenig, chef des FFI. Un second poste me sera fourni par un externe de l'hôpital, Mr Colin. Peu après, Mr Melix, un artisan électricien réfugié dans l'abri, met en état un poste à accus, ceux ci étant récupéré sur des voitures en stationnement à l'hôpital ".
Exécution des traîtres :
" Les documents militaires et politiques confiés par l'amiral, puis ultérieurement par son officier d'intendance, l'IGM Ravault, grièvement blessé auprès de son chef tué le 25 août 1944 sont dissimulés sous le grabat qui me sert de couche dans l'abri ".
" Pour la transmission des renseignements, et leur collecte, je serai aidé par le maître gendarme léger Bourdon, agent de renseignements, par sept officiers mariniers de l'unité marine mis à mes ordres, dont le maître Jardin, qui fut sévèrement touché ".
" L'aide la plus importante me fut apportée par le capitaine Berger ( Marc dans la Résistance ) commandant la compagnie Marcel Boucher ( composée presque entièrement de cheminots ), seule unité restée à l'intérieur de Brest. Cinq de ses rangs, étaient affectés à ma protection, dont Georges ( je tais son nom ) qui nous servit à l'exécution des traîtres. Grâce à leur chef, par la cantine des chemins de fer, reliée au réseau SNCF, que les Allemands avaient oublié de détruire le long des lignes, je fus en liaison presque constante avec l'extérieur libéré"
Logico- Major

- Nombre de messages : 113
Age : 99
Date d'inscription : 31/07/2006
 La Libération de Brest
La Libération de Brest
Des Documents aux Américains :
" J'ai gardé en dernier, mais non pour le moindre, mon compatriote Béarnais, le sergent pompier Palu qui m'aidait lors de la transmission des messages ".
" Le 10 septembre 1944, je suis informé par Mr Le Friec, externe, de l'arrivée d'une patrouille Américaine au voisinage de l'hôpital. J'obtiens du jeune lieutenant qui la commande, impressionné par mon grade ( je suis en uniforme comme tout mon personnel depuis le début du siège ), une communication en phonie avec l'état major américain.
Deux heures après, le colonel Hirchfelder, futur commandant de la place et le major Mathew Wood me joignent. Ils sont l'objet de manifestations d'enthousiasme qui les touchent profondément. Les documents militaires leur sont remis et seront exploités ultérieurement " .
( Docteur Max LAFFERRE ex-professeur à l'école annexe de médecine navale )
800 morts dans l'abri Sadi-Carnot :
Le lieutenant Carquin est en retraite des sapeurs pompiers de Brest. Il avait 21 ans au moment du siège de la ville. " Mon sommeil en est encore perturbé. C'était terrible ". Le 9 septembre, en pleine nuit, un incendie, suivi d'une gigantesque explosion, fait plus de huit cent morts, civils Français et militaires Allemands, dans l'abri Sadi-Carnot.
Quand Paul Carquin arrive sur les lieux, une flamme haute de 40 mètres s'échappe de la sortie haute du refuge : " C'était comme un immense chalumeau ".
Trois semaines plus tôt, le 14 août, l'évacuation générale de la ville a été ordonnée. Une voiture équipée de hauts paeleurs invite ce jour là les Brestois à partir. La veille, les bombardiers alliés ont arrosé plusieurs quartiers. Alors, la population quitte le déluge de fer et de feu.
Mais 2 000 personnes ont décidé de rester dans la poche, aux mains de troupes déterminées à livrer leur dernier combat. Des anciens, des fonctionnaires municipaux, le Président de la Délégation Spéciale de Brest et Maire de Saint-Pierre, Victor Eusen, des médecins, le secrétaire général de la sous-préfecture, la Croix Rouge, des membres de la Défense Passive, des religieux, des irréductibles, et aussi des pompiers qui vont tenter de préserver jusqu'au bout, des lambeaux d'immeubles.
L'abri de Sadi-Carnot est un long tunnel de béton auquel on accède par 154 marches abruptes qui plongent à 23 mètres sous terre. Le débouché se fait au bas de Brest, juste au dessus de l'arsenal, porte Tourville.
Depuis cinquante ans, l'abri Sadi-Carnot est fermé à chacune de ses extrémités par une grille de fer. A l'un et l'autre bout, une plaque fait le récit d'un drame qui s'est déroulé le 9 septembre 1944, à 2 H du matin et dont l'ampleur s'est traduite par environ 800 morts.
Une Armée en déroute qui fait peur :
Au fur et à mesure de la bataille, la vie s'organise dans le réduit Brestois qui attend sa libération. Les gens se sont terrés dans plusieurs abris, dont celui de Sadi-Carnot. Il fait chaud en ce mois d'août. La nuit, les incendies illuminent le ciel.
Sadi-Carnot est devenu habité. C'est de là que l'on administre ce qui reste de la ville. On y dit aussi la messe. Dans la journée, les habitants profitent des accalmies et des deux heures de sortie autorisées pour aller visiter leurs maisons.
Ils rapportent sous ce béton protecteur des chaises, des couchages, divers objets et des jouets pour les enfants. Ceux qui ne sortent pas au jour ont le plus mauvais moral, d'autant que la place devient rare. Au bout d'un certain temps, il faut évacuer les sommiers et installer des hamacs pour donner plus de place à chacun.
Le siège dure : Le général allemand Ramcke était un fanatique qui ne voulait pas se rendre. A partir du 1er septembre, sous la pression alliée, des habitants pris entre les deux feux viennent grossir la population blottie dans le souterrain envahi de puces, et à l'air de plus en plus irrespirable.
Dans Brest en état de siège, les journées et les nuits sont rythmées par les bombes, les tirs d'artillerie, les immeubles en flammes. Des soldats allemands pillent. Il suffit de défoncer les portes. L'alcool, les bijoux, c'est surtout cela qui les intéresse. Parfois ils tirent à vue.
Cette armée en déroute, jusqu'au-boutiste, qui a la gâchette facile, qui s'enivre avant de gagner la ligne de front, fait peur. Dans l'abri Sadi-Carnot, deux mondes vivent côte à côte. D'un côté les civils, de l'autre, quelque 500 Allemands.
Une cloison de bois au milieu de ce large boyau de 500 mètres, construit au début du conflit, sépare réfugiés et occupants. Ceux ci ne sont pas les plus redoutés. Ils font partie de l'Organisation Todt qui a pris possession de l'abri.
Souvent, ces derniers doivent affronter les avanies des paras qui, montant de l'arsenal pour aller en découdre avec les Américains aux marges de la ville. Les paras leur reprochent d'être les seuls à aller à la mort.
La sueur sous les cuirs :
Mais les Brestois ont aussi leurs combattants, ceux de l'impossible. Pour armes, ils ont des lances à incendie, des haches et des pioches.
Quand il n'y a plus d'eau, ils se disputent avec les Allemands pour profiter du réservoir de la Place Wilson
Marins pompiers et pompiers de la ville ont fusionné. Ils sont installés dans l'arsenal où leur matériel se trouve à l'abri. Leur front à eux, c'est le feu qui prend dans tous les coins.
Le 15 août, Charles Carquin a réuni ses pompiers civils : " Il faut évacuer la ville, ceux qui veulent partir peuvent le faire ". Vingt deux hommes choisissent de rester, dont son fils Paul et Adolphe Gautron, autres témoins de ces événements. Ces soldats pacifiques profitent des périodes de répit. Ils travaillent aussi sous les bombes.
Ils ont dévidés des km de tuyaux dans la ville. Quand c'est un endroit névralgique qui est menacé : Une boulangerie pour le ravitaillement, la clinique, l'hopital; les pompiers se battent à l'extrème, suant dans leurs bottes et sous leur cuir. Mission du dérisoire, de l'inutile. Il n'y a pas que l'action des bombes. Les Allemands aussi incendient. " Et parfois, ils rallumaient après notre passage " relate Paul Carquin .
Dans la nuit du 8 au 9 septembre, on apprend à la caserne que l'abri Sadi-Carnot est en feu. Paul Carquin est envoyé par son père avec un autre pompier, en reconnaissances, alors que les déplacements nocturnes sont interdits.
Quand ils arrivent au bas de l'abri, on entend toujours des explosions sourdes retentir. " Des corps d'Allemands brûlaient à l'extérieur ". A l'autre sortie, place Sadi-Carnot, une longue flamme monte de la bouche du refuge. " La chaleur était intense, une cinquantaine de personnes, hébêtées avaient réussi à sortir ".
Des hommes calcinés partout :
Il faudra attendre le matin pour découvrir l'ampleur de la tragédie. Paul Carquin de retour vers 5 h à la caserne sous les bombardements doit repartir deux heures plus tard. Les Allemands ont contacté les pompiers de Brest. Paul Carquin a été désigné, car il connaît bien les lieux, pour avoir participé à l'installation de quatre vingt hamacs.
Seul civil à pénétrer dans la fournaise, il tient un projecteur pendant que les autres noient l'abri. C'est l'horreur du carnage. Des hommes calcinés partout. " On a ainsi avancé petit à petit. De temps à autre, des obus partaient. A 11 h 30 nous sommes arrivés au bout de la partie Allemande ".
L'après midi, le travail à la lance alimentée à l'eau de mer se poursuit dans l'autre zone. " Un groupe de douze pompiers avait été formé. Nous sommes entré dans l'abri Français à 132 h . Il y avait des cadavres sur 1 m 50 de hauteur " se rappelle Paul Caquin. Subitement, ses yeux s'embuent : " On a du marcher sur les morts pour ne pas avoir les pieds ébouillantés par l'eau qui revenait. Il faut s'imaginer cela ". A 17 h , tout est éteint.
Essence et munitions :
373 corps dont quarante enfants seront identifiés.mais on suppose qu'il y avait bien plus de monde. Il a fallu quinze jours pour reconnaître les victimes. Le Docteur Alexis Corre, médecin chef de la défense passive, dernier témoin de la vie à Sadi-
Carnot qu'il quitta le 22 août pour établir à un autre endroit de la ville, un poste de secours, a participé à cette terrible restitution. " Des canalisations s'étant rompues, on pataugeait pour retrouver les restes. Trois mois après, je sentais encore la mort ".
500 Allemands estime-t-on, ont également péri, sans qu'on ai véritablement su leur nombre dans l'abri. C'est dans leur partie que tout a démarré. Plusieurs versions circulent sur l'origine du drame. Courts-circuits, obus, bagarre entre Allemands, hypothèse la plus admise. Selon un témoignage recueilli sur place par Paul Carquin, de l'essence s'est enflammée. " Il y avait une réserve de trois à quatre fûts de 200 litres, à la porte ". Et surtout était entreposée à l'intérieur, une importante quantité de munitions… Des Allemands ont alors traversé le boyau en courant vers la zone française, en criant au feu. Ceux qui ont réagi vite ont pu se précipiter vers la sortie. Mais la porte ne s'ouvrait que de l'intérieur. L'abri s'est transformé pour la plupart en souricière et en enfer à neuf jours du silence des canons.
Une armée en décomposition :
Il est entré dans une ville paisible, et ce sont des ruines fumantes qu'il a quittées. Un soldat télégraphiste a vécu le siège de Brest, de l'autre côté, c'est à dire au sein de l'armée allemande dont il était seconde classe. De retour dans son pays, il publie une pièce radiophonique dans laquelle il stigmatise l'attitude du général Ramcke, commandant de la place militaire de Brest, ce qui lui vaudra des démêlés judiciaires avec l'intéressé.
Le 29 juin, terminus, Erich découvre Brest. Il vient de mettre quatorze jours pour traverser la France en train. Dans le convoi qu'il est chargé de surveiller se trouve entre autres choses, vingt sept vélo, destinés à la forteresse de Brest.
Alors que cela sent partout la débâcle nazie, ce chargement fait sourire Erich ( Erich Kuby, 34 ans, originaire de Baden-Baden, pas trop mécontent d'aboutir au bout du Finistère, même si au premier abord la ville lui semble des plus laides.
Il vient en effet de passer trois ans sur le front russe, s'est retrouvé devant un tribunal militaire pour son peu d'empressement à se mouler dans l'armée du Furher; et a même échappé à la condamnation à mort avant de recevoir en mai 1944 une nouvelle affectation pour une autre terre lointaine.
" Ma Guerre " :
Le seconde classe télégraphiste débarque donc dans une ville qui sent apparemment la paix. Mais la forteresse souterraine où vit la défense allemande, il découvre une réalité militaire qu'il exècre, celle des ordres et des contre-ordres, des sous-officiers qui répercutent sur leurs inférieurs la servilité dont ils doivent faire preuve.
Erich Kuby couche jour après jour sur le papier, les impressions que lui procurent le spectacle d'une armée craintive dans l'attente du lendemain. C'est la suite et (fin) de son journal de guerre, destiné discrètement à sa femme. En tout 10 000 pages dont il tirera en 1975, un livre intitulé "Ma guerre" par référence ironique à " Mein Kampf ".
Maurice Haslé, maître de conférence, à l'université de Bretagne occidentale est tombé par hasard sur ce livre et a voulu faire connaissance avec l'auteur.
" Ils dégobillent " :
Il a découvert en 1989 un "jeune homme de 79 ans" aussi critique que cinquante ans plus tôt. Fils de famille bourgeoise, anti-nazi et anti-militariste, Erich Kuby n'est pas un anonyme.
Il réside à Venise, a publié une trentaine de livres et a été journaliste au "Stern". Confronté quotidiennement avec les criminelles vagues d'assaut et le fétide clapotis de la peste brune qui ravageait l'Europe, il a su rester propre selon Maurice Haslé.
Son témoignage rédigé d'une plume alerte et ironique est une pièce majeure à verser sur l'histoire du siège de Brest.. Il montre une armée dont des galonnés, déboussolés, apeurés, dans leurs bunkers se défoncent à l'alcool la nuit et récupèrent le jour.
" Dans leurs beuveries, ils font tous leurs besoins dans les seaux, dégobillent, et le lendemain matin, quelques pauvres cons doivent monter 84 marches, monter les seaux à la surface et tout nettoyer " relate Erich Kuby, qui s'interroge : " Que feront ces gens quand ils rentreront dans leurs familles ? ".
Cette armée en décomposition donne l'impression d'y croire encore malgré une issue inévitable. Les chefs font récupérer le cuivre des lignes télégraphiques pour le recycler dans les fonderies allemandes à 2 000 km de là. Quelques heures avant la victoire Américaine on affiche des messages de Goebels annonçant aux rescapés de l'assaut, qu'ils sont entré dans l'histoire.
Ce deuxième classe montre à quel point l'obéissance aveugle peut entraîner à la mort des milliers d'hommes.
" J'ai gardé en dernier, mais non pour le moindre, mon compatriote Béarnais, le sergent pompier Palu qui m'aidait lors de la transmission des messages ".
" Le 10 septembre 1944, je suis informé par Mr Le Friec, externe, de l'arrivée d'une patrouille Américaine au voisinage de l'hôpital. J'obtiens du jeune lieutenant qui la commande, impressionné par mon grade ( je suis en uniforme comme tout mon personnel depuis le début du siège ), une communication en phonie avec l'état major américain.
Deux heures après, le colonel Hirchfelder, futur commandant de la place et le major Mathew Wood me joignent. Ils sont l'objet de manifestations d'enthousiasme qui les touchent profondément. Les documents militaires leur sont remis et seront exploités ultérieurement " .
( Docteur Max LAFFERRE ex-professeur à l'école annexe de médecine navale )
800 morts dans l'abri Sadi-Carnot :
Le lieutenant Carquin est en retraite des sapeurs pompiers de Brest. Il avait 21 ans au moment du siège de la ville. " Mon sommeil en est encore perturbé. C'était terrible ". Le 9 septembre, en pleine nuit, un incendie, suivi d'une gigantesque explosion, fait plus de huit cent morts, civils Français et militaires Allemands, dans l'abri Sadi-Carnot.
Quand Paul Carquin arrive sur les lieux, une flamme haute de 40 mètres s'échappe de la sortie haute du refuge : " C'était comme un immense chalumeau ".
Trois semaines plus tôt, le 14 août, l'évacuation générale de la ville a été ordonnée. Une voiture équipée de hauts paeleurs invite ce jour là les Brestois à partir. La veille, les bombardiers alliés ont arrosé plusieurs quartiers. Alors, la population quitte le déluge de fer et de feu.
Mais 2 000 personnes ont décidé de rester dans la poche, aux mains de troupes déterminées à livrer leur dernier combat. Des anciens, des fonctionnaires municipaux, le Président de la Délégation Spéciale de Brest et Maire de Saint-Pierre, Victor Eusen, des médecins, le secrétaire général de la sous-préfecture, la Croix Rouge, des membres de la Défense Passive, des religieux, des irréductibles, et aussi des pompiers qui vont tenter de préserver jusqu'au bout, des lambeaux d'immeubles.
L'abri de Sadi-Carnot est un long tunnel de béton auquel on accède par 154 marches abruptes qui plongent à 23 mètres sous terre. Le débouché se fait au bas de Brest, juste au dessus de l'arsenal, porte Tourville.
Depuis cinquante ans, l'abri Sadi-Carnot est fermé à chacune de ses extrémités par une grille de fer. A l'un et l'autre bout, une plaque fait le récit d'un drame qui s'est déroulé le 9 septembre 1944, à 2 H du matin et dont l'ampleur s'est traduite par environ 800 morts.
Une Armée en déroute qui fait peur :
Au fur et à mesure de la bataille, la vie s'organise dans le réduit Brestois qui attend sa libération. Les gens se sont terrés dans plusieurs abris, dont celui de Sadi-Carnot. Il fait chaud en ce mois d'août. La nuit, les incendies illuminent le ciel.
Sadi-Carnot est devenu habité. C'est de là que l'on administre ce qui reste de la ville. On y dit aussi la messe. Dans la journée, les habitants profitent des accalmies et des deux heures de sortie autorisées pour aller visiter leurs maisons.
Ils rapportent sous ce béton protecteur des chaises, des couchages, divers objets et des jouets pour les enfants. Ceux qui ne sortent pas au jour ont le plus mauvais moral, d'autant que la place devient rare. Au bout d'un certain temps, il faut évacuer les sommiers et installer des hamacs pour donner plus de place à chacun.
Le siège dure : Le général allemand Ramcke était un fanatique qui ne voulait pas se rendre. A partir du 1er septembre, sous la pression alliée, des habitants pris entre les deux feux viennent grossir la population blottie dans le souterrain envahi de puces, et à l'air de plus en plus irrespirable.
Dans Brest en état de siège, les journées et les nuits sont rythmées par les bombes, les tirs d'artillerie, les immeubles en flammes. Des soldats allemands pillent. Il suffit de défoncer les portes. L'alcool, les bijoux, c'est surtout cela qui les intéresse. Parfois ils tirent à vue.
Cette armée en déroute, jusqu'au-boutiste, qui a la gâchette facile, qui s'enivre avant de gagner la ligne de front, fait peur. Dans l'abri Sadi-Carnot, deux mondes vivent côte à côte. D'un côté les civils, de l'autre, quelque 500 Allemands.
Une cloison de bois au milieu de ce large boyau de 500 mètres, construit au début du conflit, sépare réfugiés et occupants. Ceux ci ne sont pas les plus redoutés. Ils font partie de l'Organisation Todt qui a pris possession de l'abri.
Souvent, ces derniers doivent affronter les avanies des paras qui, montant de l'arsenal pour aller en découdre avec les Américains aux marges de la ville. Les paras leur reprochent d'être les seuls à aller à la mort.
La sueur sous les cuirs :
Mais les Brestois ont aussi leurs combattants, ceux de l'impossible. Pour armes, ils ont des lances à incendie, des haches et des pioches.
Quand il n'y a plus d'eau, ils se disputent avec les Allemands pour profiter du réservoir de la Place Wilson
Marins pompiers et pompiers de la ville ont fusionné. Ils sont installés dans l'arsenal où leur matériel se trouve à l'abri. Leur front à eux, c'est le feu qui prend dans tous les coins.
Le 15 août, Charles Carquin a réuni ses pompiers civils : " Il faut évacuer la ville, ceux qui veulent partir peuvent le faire ". Vingt deux hommes choisissent de rester, dont son fils Paul et Adolphe Gautron, autres témoins de ces événements. Ces soldats pacifiques profitent des périodes de répit. Ils travaillent aussi sous les bombes.
Ils ont dévidés des km de tuyaux dans la ville. Quand c'est un endroit névralgique qui est menacé : Une boulangerie pour le ravitaillement, la clinique, l'hopital; les pompiers se battent à l'extrème, suant dans leurs bottes et sous leur cuir. Mission du dérisoire, de l'inutile. Il n'y a pas que l'action des bombes. Les Allemands aussi incendient. " Et parfois, ils rallumaient après notre passage " relate Paul Carquin .
Dans la nuit du 8 au 9 septembre, on apprend à la caserne que l'abri Sadi-Carnot est en feu. Paul Carquin est envoyé par son père avec un autre pompier, en reconnaissances, alors que les déplacements nocturnes sont interdits.
Quand ils arrivent au bas de l'abri, on entend toujours des explosions sourdes retentir. " Des corps d'Allemands brûlaient à l'extérieur ". A l'autre sortie, place Sadi-Carnot, une longue flamme monte de la bouche du refuge. " La chaleur était intense, une cinquantaine de personnes, hébêtées avaient réussi à sortir ".
Des hommes calcinés partout :
Il faudra attendre le matin pour découvrir l'ampleur de la tragédie. Paul Carquin de retour vers 5 h à la caserne sous les bombardements doit repartir deux heures plus tard. Les Allemands ont contacté les pompiers de Brest. Paul Carquin a été désigné, car il connaît bien les lieux, pour avoir participé à l'installation de quatre vingt hamacs.
Seul civil à pénétrer dans la fournaise, il tient un projecteur pendant que les autres noient l'abri. C'est l'horreur du carnage. Des hommes calcinés partout. " On a ainsi avancé petit à petit. De temps à autre, des obus partaient. A 11 h 30 nous sommes arrivés au bout de la partie Allemande ".
L'après midi, le travail à la lance alimentée à l'eau de mer se poursuit dans l'autre zone. " Un groupe de douze pompiers avait été formé. Nous sommes entré dans l'abri Français à 132 h . Il y avait des cadavres sur 1 m 50 de hauteur " se rappelle Paul Caquin. Subitement, ses yeux s'embuent : " On a du marcher sur les morts pour ne pas avoir les pieds ébouillantés par l'eau qui revenait. Il faut s'imaginer cela ". A 17 h , tout est éteint.
Essence et munitions :
373 corps dont quarante enfants seront identifiés.mais on suppose qu'il y avait bien plus de monde. Il a fallu quinze jours pour reconnaître les victimes. Le Docteur Alexis Corre, médecin chef de la défense passive, dernier témoin de la vie à Sadi-
Carnot qu'il quitta le 22 août pour établir à un autre endroit de la ville, un poste de secours, a participé à cette terrible restitution. " Des canalisations s'étant rompues, on pataugeait pour retrouver les restes. Trois mois après, je sentais encore la mort ".
500 Allemands estime-t-on, ont également péri, sans qu'on ai véritablement su leur nombre dans l'abri. C'est dans leur partie que tout a démarré. Plusieurs versions circulent sur l'origine du drame. Courts-circuits, obus, bagarre entre Allemands, hypothèse la plus admise. Selon un témoignage recueilli sur place par Paul Carquin, de l'essence s'est enflammée. " Il y avait une réserve de trois à quatre fûts de 200 litres, à la porte ". Et surtout était entreposée à l'intérieur, une importante quantité de munitions… Des Allemands ont alors traversé le boyau en courant vers la zone française, en criant au feu. Ceux qui ont réagi vite ont pu se précipiter vers la sortie. Mais la porte ne s'ouvrait que de l'intérieur. L'abri s'est transformé pour la plupart en souricière et en enfer à neuf jours du silence des canons.
Une armée en décomposition :
Il est entré dans une ville paisible, et ce sont des ruines fumantes qu'il a quittées. Un soldat télégraphiste a vécu le siège de Brest, de l'autre côté, c'est à dire au sein de l'armée allemande dont il était seconde classe. De retour dans son pays, il publie une pièce radiophonique dans laquelle il stigmatise l'attitude du général Ramcke, commandant de la place militaire de Brest, ce qui lui vaudra des démêlés judiciaires avec l'intéressé.
Le 29 juin, terminus, Erich découvre Brest. Il vient de mettre quatorze jours pour traverser la France en train. Dans le convoi qu'il est chargé de surveiller se trouve entre autres choses, vingt sept vélo, destinés à la forteresse de Brest.
Alors que cela sent partout la débâcle nazie, ce chargement fait sourire Erich ( Erich Kuby, 34 ans, originaire de Baden-Baden, pas trop mécontent d'aboutir au bout du Finistère, même si au premier abord la ville lui semble des plus laides.
Il vient en effet de passer trois ans sur le front russe, s'est retrouvé devant un tribunal militaire pour son peu d'empressement à se mouler dans l'armée du Furher; et a même échappé à la condamnation à mort avant de recevoir en mai 1944 une nouvelle affectation pour une autre terre lointaine.
" Ma Guerre " :
Le seconde classe télégraphiste débarque donc dans une ville qui sent apparemment la paix. Mais la forteresse souterraine où vit la défense allemande, il découvre une réalité militaire qu'il exècre, celle des ordres et des contre-ordres, des sous-officiers qui répercutent sur leurs inférieurs la servilité dont ils doivent faire preuve.
Erich Kuby couche jour après jour sur le papier, les impressions que lui procurent le spectacle d'une armée craintive dans l'attente du lendemain. C'est la suite et (fin) de son journal de guerre, destiné discrètement à sa femme. En tout 10 000 pages dont il tirera en 1975, un livre intitulé "Ma guerre" par référence ironique à " Mein Kampf ".
Maurice Haslé, maître de conférence, à l'université de Bretagne occidentale est tombé par hasard sur ce livre et a voulu faire connaissance avec l'auteur.
" Ils dégobillent " :
Il a découvert en 1989 un "jeune homme de 79 ans" aussi critique que cinquante ans plus tôt. Fils de famille bourgeoise, anti-nazi et anti-militariste, Erich Kuby n'est pas un anonyme.
Il réside à Venise, a publié une trentaine de livres et a été journaliste au "Stern". Confronté quotidiennement avec les criminelles vagues d'assaut et le fétide clapotis de la peste brune qui ravageait l'Europe, il a su rester propre selon Maurice Haslé.
Son témoignage rédigé d'une plume alerte et ironique est une pièce majeure à verser sur l'histoire du siège de Brest.. Il montre une armée dont des galonnés, déboussolés, apeurés, dans leurs bunkers se défoncent à l'alcool la nuit et récupèrent le jour.
" Dans leurs beuveries, ils font tous leurs besoins dans les seaux, dégobillent, et le lendemain matin, quelques pauvres cons doivent monter 84 marches, monter les seaux à la surface et tout nettoyer " relate Erich Kuby, qui s'interroge : " Que feront ces gens quand ils rentreront dans leurs familles ? ".
Cette armée en décomposition donne l'impression d'y croire encore malgré une issue inévitable. Les chefs font récupérer le cuivre des lignes télégraphiques pour le recycler dans les fonderies allemandes à 2 000 km de là. Quelques heures avant la victoire Américaine on affiche des messages de Goebels annonçant aux rescapés de l'assaut, qu'ils sont entré dans l'histoire.
Ce deuxième classe montre à quel point l'obéissance aveugle peut entraîner à la mort des milliers d'hommes.
Logico- Major

- Nombre de messages : 113
Age : 99
Date d'inscription : 31/07/2006
 La Libération de Brest
La Libération de Brest
Jusqu'à la dernière cartouche :
Parlant du général Ramcke, Erich Kuby s'interroge : " Un ordre est il pour lui une frontière absolue au-delà de laquelle il est incapable e penser et d'avoir des sentiments ? " qui nous apprend que Ramcke n'a jeté l'éponge que lorsque le furher lui a décerné la distinction suprême : Chevalier de la croix de fer avec feuilles de chêne, glaives et brillants…
En dépit des offres de reddition dont celle du 13 septembre du général Middleton Ramcke avait refusé de déposer les armes. " Jusqu'à la dernière cartouche " avait-il dit à ses hommes "et quand vous l'aurez tirée, jetez les douilles vides à la face de votre ennemi"
Une vision d'apocalypse :
Partis au début de la guerre dans les Forces Françaises Libres, emportés par l'exode, enrôlés malgré eux dans le Service du Travail Obligatoire, obligés enfin de quitter leur ville natale à la veille de sa mise à mort par la conjonction des tirs allemands, anglais et américains, nombre de Brestois n'ont jamais revu la cité de leurs souvenirs.
Brest et ses ruines fumantes, Brest rasée et redessinée par les bulldozers, Brest au début de sa résurrection. Des témoins d'alors se souviennent de leur première vision.
Une odeur épouvantable :
Michel Quéméré, ancien président de l'ORPAB, avait 24 ans en ce mois d'août 1944. Chargé de famille (sa mère et sa sœur), après avoir fait cinq ans dans la marine, il exerce des petits boulots d'électricité. Donnant de loin en loin des renseignements aux résistants de la région Brestoise, il décide de rester à Brest pour voir s'il peut servir à quelque chose. Il se souvient surtout des mouvements de troupes consécutifs aux replis du général Ramcke à Brest et du bruit des blindés remontant de nuit la rue Anatole France.
Arrivée au Polygone :
Le 14 août, il quitte Brest et prend la direction de Plouvien où il offrira son aide au maquis. Le 19 septembre 1944, au lendemain de la libération de brest, Michel Quéméré enfourche son vélo et décide de rallier Recouvrance.
" Ma mère avait laissé chez nous des papiers et des vêtements qu'elle jugeait indispensables. Je suis passé par Guilers, puis par le polygone. Là, j'ai eu une vision de désolation, il n'y avait presque plus de maisons.
Tout était calciné. Ce qui m'a frappé, c'est l'odeur épouvantable, provenant de cadavres de chevaux. Partout, du matériel hors d'usage, des mines anti-chars et puis le silence, un très grand calme ".
De retour chez lui, prés du cimetière de Recouvrance, Mr Quéméré que la maison a été traversée de part en part par un obus qui n'a pas explosé. La demeure familiale a été pillée, rien de bien original.
La vie au ralenti :
Tant qu'à être venu jusque là, Mr Quéméré décide d'aller voir ce qui reste de son quartier… " Il était difficile de passer, beaucoup de maisons étant atteintes par le feu. Ce qui m'a frappé, c'est le pont détruit. De l'autre côté de la Penfeld, l'hôtel du Départ semblait intact. Je me souviens aussi du bas de la rue Louis Pasteur, totalement envahi par les gravats.
Michel Quéméré passera un jour et une nuit dans ce Brest méconnaissable et totalement invivable. " Dans les jours qui ont suivi, il n'y a pas eu de liesse comme dans les autres villes libérées. La ville était détruite, il n'y avait personne, la vie était au ralenti ".
Le gâchis de la reconstruction :
Le 6 juin 1944, alors qu'il débarquait sur les plages de Normandie avec les troupes de la 2ème D.B. du général Leclerc, M.D. (qui a souhaité garder l'anonymat), avait d'autres préoccupations que sa ville natale à la pointe du finistère.
Le devoir accompli, il y entre en mars-avril 1945. " C'était une catastrophe, tout était démoli, Brest était rectifié. Que la route m'avait semblé longue pour rejoindre à pieds Saint-Pierre, où une maison sur deux était au sol. Quand on se promenait du côté de Sainte-Anne, il fallait faire attention aux blockhaus, aux munitions, aux mines ".
" Mais pour ma part, en tant que constructeur de bateaux, j'avais été atteint bien avant, lors du sabordage e Toulon. A l'opposé, mon retour sur la terre de France aura été l'un des moments les plus forts de cette époque. Que d'amertumes et de regrets, d'avoir ainsi été bluffé avant la guerre. Cela nous faisait mal. Ca nous fait toujours mal ".
Retour en 1949 :
Après avoir repris du service à l'arsenal en 1949 M.D. revient à Brest. " La ville avait beaucoup changé. Je me suis dit : Ca a de la gueule, on reconstruit bien. Et puis plus tard j'ai vu les sinistres tours de Queliverzan, les bicoques de Kérango, le désastre de Saint-Pierre. On a réussi à enterrer les remparts de Brest, qui étaient pour notre génération quelque chose de formidable. Franchement, je ne m'attendais pas à autant de gâchis. Je ne me l'explique toujours pas ".
La maison encore debout :
Le 22 octobre 1942, Paul Coat faisait partie des 600 ouvriers de l'arsenal pris par l'occupant allemand et envoyés à Hambourg dans le cadre du Service du Travail Obligatoire. 45 mois plus tard, à l'issue d'une véritable épopée d'Est en Ouest, il revient à Brest par le train.
" Ma première impression, c'est de voir la gare envahie par des femmes, mères, sœurs, fiancées, venant tous les jours dans l'espoir de voir celui qu'on attend, sans savoir s'il est vivant ou mort. Ensuite, je me souviens du centre d'accueil, où les arrivants étaient aiguillés vers Milizac. Puis ce fut la maison de mes parents, toujours debout route du Valy-Hir, nous avions eu de la chance ".
Entre septembre 1944 et mai 1945, le déblayage mobilisant des milliers de personnes a considérablement avancé. Paul Coat n'est donc pas confronté à une "vision d'apocalypse". et pourtant la ville était méconnaissable.
" En descendant la rue de Siam, on était complètement abrutis par le spectacle. La rue Louis Pasteur n'était plus qu'un sentier au milieu des ruines. La scène la plus frappante était peut être de voir les civils entrer dans l'arsenal pour passer le pont ".
" Mais finalement, je crois qu'à l'époque, le bonheur de retrouver la famille, les amis vivants, les difficultés de ravitaillement prenaient le pas sur les destructions et la nostalgie. On ne se rendait pas compte du désastre subi par le patrimoine ".
Parlant du général Ramcke, Erich Kuby s'interroge : " Un ordre est il pour lui une frontière absolue au-delà de laquelle il est incapable e penser et d'avoir des sentiments ? " qui nous apprend que Ramcke n'a jeté l'éponge que lorsque le furher lui a décerné la distinction suprême : Chevalier de la croix de fer avec feuilles de chêne, glaives et brillants…
En dépit des offres de reddition dont celle du 13 septembre du général Middleton Ramcke avait refusé de déposer les armes. " Jusqu'à la dernière cartouche " avait-il dit à ses hommes "et quand vous l'aurez tirée, jetez les douilles vides à la face de votre ennemi"
Une vision d'apocalypse :
Partis au début de la guerre dans les Forces Françaises Libres, emportés par l'exode, enrôlés malgré eux dans le Service du Travail Obligatoire, obligés enfin de quitter leur ville natale à la veille de sa mise à mort par la conjonction des tirs allemands, anglais et américains, nombre de Brestois n'ont jamais revu la cité de leurs souvenirs.
Brest et ses ruines fumantes, Brest rasée et redessinée par les bulldozers, Brest au début de sa résurrection. Des témoins d'alors se souviennent de leur première vision.
Une odeur épouvantable :
Michel Quéméré, ancien président de l'ORPAB, avait 24 ans en ce mois d'août 1944. Chargé de famille (sa mère et sa sœur), après avoir fait cinq ans dans la marine, il exerce des petits boulots d'électricité. Donnant de loin en loin des renseignements aux résistants de la région Brestoise, il décide de rester à Brest pour voir s'il peut servir à quelque chose. Il se souvient surtout des mouvements de troupes consécutifs aux replis du général Ramcke à Brest et du bruit des blindés remontant de nuit la rue Anatole France.
Arrivée au Polygone :
Le 14 août, il quitte Brest et prend la direction de Plouvien où il offrira son aide au maquis. Le 19 septembre 1944, au lendemain de la libération de brest, Michel Quéméré enfourche son vélo et décide de rallier Recouvrance.
" Ma mère avait laissé chez nous des papiers et des vêtements qu'elle jugeait indispensables. Je suis passé par Guilers, puis par le polygone. Là, j'ai eu une vision de désolation, il n'y avait presque plus de maisons.
Tout était calciné. Ce qui m'a frappé, c'est l'odeur épouvantable, provenant de cadavres de chevaux. Partout, du matériel hors d'usage, des mines anti-chars et puis le silence, un très grand calme ".
De retour chez lui, prés du cimetière de Recouvrance, Mr Quéméré que la maison a été traversée de part en part par un obus qui n'a pas explosé. La demeure familiale a été pillée, rien de bien original.
La vie au ralenti :
Tant qu'à être venu jusque là, Mr Quéméré décide d'aller voir ce qui reste de son quartier… " Il était difficile de passer, beaucoup de maisons étant atteintes par le feu. Ce qui m'a frappé, c'est le pont détruit. De l'autre côté de la Penfeld, l'hôtel du Départ semblait intact. Je me souviens aussi du bas de la rue Louis Pasteur, totalement envahi par les gravats.
Michel Quéméré passera un jour et une nuit dans ce Brest méconnaissable et totalement invivable. " Dans les jours qui ont suivi, il n'y a pas eu de liesse comme dans les autres villes libérées. La ville était détruite, il n'y avait personne, la vie était au ralenti ".
Le gâchis de la reconstruction :
Le 6 juin 1944, alors qu'il débarquait sur les plages de Normandie avec les troupes de la 2ème D.B. du général Leclerc, M.D. (qui a souhaité garder l'anonymat), avait d'autres préoccupations que sa ville natale à la pointe du finistère.
Le devoir accompli, il y entre en mars-avril 1945. " C'était une catastrophe, tout était démoli, Brest était rectifié. Que la route m'avait semblé longue pour rejoindre à pieds Saint-Pierre, où une maison sur deux était au sol. Quand on se promenait du côté de Sainte-Anne, il fallait faire attention aux blockhaus, aux munitions, aux mines ".
" Mais pour ma part, en tant que constructeur de bateaux, j'avais été atteint bien avant, lors du sabordage e Toulon. A l'opposé, mon retour sur la terre de France aura été l'un des moments les plus forts de cette époque. Que d'amertumes et de regrets, d'avoir ainsi été bluffé avant la guerre. Cela nous faisait mal. Ca nous fait toujours mal ".
Retour en 1949 :
Après avoir repris du service à l'arsenal en 1949 M.D. revient à Brest. " La ville avait beaucoup changé. Je me suis dit : Ca a de la gueule, on reconstruit bien. Et puis plus tard j'ai vu les sinistres tours de Queliverzan, les bicoques de Kérango, le désastre de Saint-Pierre. On a réussi à enterrer les remparts de Brest, qui étaient pour notre génération quelque chose de formidable. Franchement, je ne m'attendais pas à autant de gâchis. Je ne me l'explique toujours pas ".
La maison encore debout :
Le 22 octobre 1942, Paul Coat faisait partie des 600 ouvriers de l'arsenal pris par l'occupant allemand et envoyés à Hambourg dans le cadre du Service du Travail Obligatoire. 45 mois plus tard, à l'issue d'une véritable épopée d'Est en Ouest, il revient à Brest par le train.
" Ma première impression, c'est de voir la gare envahie par des femmes, mères, sœurs, fiancées, venant tous les jours dans l'espoir de voir celui qu'on attend, sans savoir s'il est vivant ou mort. Ensuite, je me souviens du centre d'accueil, où les arrivants étaient aiguillés vers Milizac. Puis ce fut la maison de mes parents, toujours debout route du Valy-Hir, nous avions eu de la chance ".
Entre septembre 1944 et mai 1945, le déblayage mobilisant des milliers de personnes a considérablement avancé. Paul Coat n'est donc pas confronté à une "vision d'apocalypse". et pourtant la ville était méconnaissable.
" En descendant la rue de Siam, on était complètement abrutis par le spectacle. La rue Louis Pasteur n'était plus qu'un sentier au milieu des ruines. La scène la plus frappante était peut être de voir les civils entrer dans l'arsenal pour passer le pont ".
" Mais finalement, je crois qu'à l'époque, le bonheur de retrouver la famille, les amis vivants, les difficultés de ravitaillement prenaient le pas sur les destructions et la nostalgie. On ne se rendait pas compte du désastre subi par le patrimoine ".
Logico- Major

- Nombre de messages : 113
Age : 99
Date d'inscription : 31/07/2006
 La Libération de Brest
La Libération de Brest
L'épopée des nettoyeurs de la rade :
Emile Le Bourdiec, cet homme volubile, solidement planté, était scaphandrier en 1945. De ceux qui participèrent dans les années d'après guerre au relèvement des épaves encombrant le port et la rade de Brest. Ils ne sont plus que trois ou quatre à pouvoir évoquer cette épopée quotidienne.
Le travail réalisé par ces hommes a été non seulement titanesque, mais également un travail à hauts risques.
140 000 tonnes :
A l'époque " Les Abeilles ", pour le compte de laquelle travaillait Emile Le Bourdiec, était la compagnie la plus puissante. Elle ne fut pourtant pas la seule à travailler à la remise en route des ports de guerre et de commerce.
Le colossal chantier mobilisa aussi les compagnies "Neptune", "Océanique", "Charles de Marseille", éLa société Armoricaine de draguage", puis épisodiquement des Anglais et des Hollandais…
Le nettoyage du plan d'eau commença dés le mois de décembre 1944. On dénombra jusqu'à 600 épaves représentant 140 000 tonnes.
Il a fallu tout faire sauter :
Le dégagement progressif de la Penfeld fait partie des incontournables symboles de cette aventure. Plus encore que du renflouement du ponton-grue allemand Umbert (200 t) renversé prés du parc au ducs sous le château, ce sont les travaux effectués sur les deux volées du Pont National qui reviennent en mémoire.
" C'était un travail délicat qui a pris plusieurs mois. L'épave était très inclinée, profondément plantée. Il a fallu désolidariser les pièces à terre avant de procéder au découpage sous-marin. Quand on a posé les chaînes, quelque chose s'est cassé, l'envasement avait été sous-estimé. Je me souviens d'un collègue ému de voir au fond les réverbères du pont englouti. Cela faisait partie de notre passé, il a fallu tout faire sauter ".
En mars 1946, la Penfeld redevenait navigable, malgré la présence un peu plus en amont de l'épave de la nacelle du pont transbordeur et d'une montagne de filins d'acier, de vestiges de camions et de matériels militaires.
La mort de Montoya :
A la demande des autorités maritimes, qui souhaitaient y installer le "Jean Bart", le dégagement des bassins 8 et 9 fit également partie des priorités. " L'énorme épave d'un cargo mixte allemand de 200 m de long s'y trouvait. Il a aussi fallu remettre en état la porte du bassin et en dégager l'accès bloqué par des filets anti-torpilles ".
L'opération demanda plus d'un an de travail et coûta la vie au scaphandrier Montoya :
" Sa vitre de casque s'est dévissée au cours d'une descente. On travaillait dans des conditions difficiles, parfois par 35 m de fond, sans visibilité. Alors durant les élinguages, il fallait se méfier des serpents de filins d'acier se baladant entre deux eaux. De même en creusant des tunnels dans la vase, sous les épaves, nous prenions parfois des risques énormes ".
La rade propre en 1948 :
Le "Krosforn" à l'entrée de la passe sud, le "Waldeck Rousseau", la "Dordogne" prés de Roscanvel, la partie centrale du "Clémenceau" immergée par les Allemands, le Croiseur "Gueydon" qu'il fallut couper en trois, l' "Ockland" bâtiment Suédois transformé en navire hôpital et gisant prés du bassin des flottilles…
Dans le flot des souvenirs d'Emile Le Bourdiec, ce sont toutes les épaves qui reviennent à la surface du temps. " Souvent les coquilliers nous en signalaient la présence après avoir accroché leurs filets. Il m'est arrivé de tomber sans le vouloir sur une passerelle entière de navire. C'est vrai que quand on a fait ce que les scaphandriers d'alors ont fait, le reste est de la rigolade. On n'avait plus beaucoup de surprises professionnelles par la suite ".
Grâce à ces professionnels du risque, le port fut rapidement dégagé. Le 20 mars 1945 le "Paul Lemerle" immobilisait ses 4 000 tonneaux au cinquième bassin du port de commerce. Deux mois plus tard, c'était au tour du "Liberty Ship Carlson" d'y accoster. Petit à petit, les remous de la guerre s'estompaient. En 1948, la rade était déclarée " propre et complètement praticable " et le chantier de Brest dissous.
Le duo de la Reconstruction :
Mathon et Piquemal :
A ceux qui veulent comprendre l'histoire contemporaine de Brest, on ne saurait trop conseiller la lecture de " Brest alias Brest ", œuvre de plusieurs historiens locaux.
L'un d'eux, Yves Gallo, brosse dans cet ouvrage un petit portrait des deux hommes qui ont marqué la reconstruction : Maurice Piquemal et Jean-Baptiste Mathon.
Du premier ingénieur des Ponts et Chaussée il dit : " Tignasse en brosse compacte, sourcils et moustaches hérissés, geste chaleureux, regard jovial, faconde aquitaine, ce grand commis était un homme de cœur et de conscience très proche du petit peuple, à l'égard duquel il se reconnaissait le devoir de loger et de reloger en faisant vite.
En conséquence de quoi, s'accommodant de la médiocrité des crédits et des moyens, il établissait des records, fabriquant et superposant, sans reprendre haleine des km2 de plancher. Maurice Piquemal ne faisait pas ses délices de la lecture de Lamartine. Mais ce genre de dévergondage n'est pas fréquent dans le corps auquel il appartenait. Il lui sera donc beaucoup pardonné ".
" Ce sera moins le cas de l'urbaniste Jean Baptiste Mathon. Cet ancien combattant de la guerre 14, Grand prix de Rome déjà embaumé par les honneurs, condescendait parfois à quitter les bords de la Seine pour venir discuter dans la paisible préfecture de Quimper des affaires de Brest, qu'il n'accablait pas de ses visites ".
" On a cru devoir lui rendre un hommage qu'il ne méritait sans doute pas. Hommage ambigu : La plaque de marbre gravée à son nom a été placée au niveau du trottoir, si bien qu'elle semble réservée à la lecture et à la méditation des toutous baguenaudeurs dont notre ville n'est pas dépourvue. On ne saurait comparer la terne reconstruction de Brest à celle de Saint-Malo ".
Au bois de sapins ma maison était en carton :
Sinistrée à Recouvrance et réfugiée dans la presqu'île de Crozon pendant l'Occupation, ma famille est revenue habiter Brest en 1948. Une " baraque américaine " portant le N° B 12 lui avait été attribuée - enfin ! – dans un endroit appelé le "Bois-de-Sapins".
Ce petit quartier qui comptait une cinquantaine de baraques préfabriquées aux Etats-Unis avait été aménagé au milieu des champs, au fond d'une impasse (devenue la rue Théodore-Bothrel), accessible par la rue du commandant Drogou, la grande voie qui menait de Kérinou au Bergot.
Un excellent esprit régnait chez les habitants de ce village où la solidarité n'était pas un vain mot. " Nous nous connaissions tous car nous nous croisions sans arrêt dans les allées à une époque où l'on ne circulait pas en voiture et où la télévision ne nous confinait pas encore dans nos logements. Nous appartenions à des familles de petits fonctionnaires, d'officiers mariniers, d'ouvriers de l'arsenal ou du bâtiment.
Les parents étaient tous heureux de retrouver Brest après les années noires et de bénéficier de logements confortables pour l'époque en attendant de retrouver des maisons en dur ".
Ah, la belle baignoire ! :
Au Bois de sapins, nous avons le sentiment d'être des privilégiés, parce que nous habitons des baraques américaines.
Par rapport aux baraques dites Françaises ( mais étaient-elles vraiement de fabrication française?), nos petites maisons avaient la particularité de posséder une vraie salle de bains équipée d'une superbe baignoire émaillée, un luxe pour l'époque.
C'était une merveille que nous enviaient nos camarades des quartiers voisins de Kérédem, du Bergot ou du Bouguen.
Cette baignoire, il faut le reconnaître, était bien sûr fort commode pour la toilette, mais elle était surtout appréciée par les mères de famille qui pouvaient y faire la lessive sans sortir de chez elles.
Les plus folles rumeurs couraient sur l'utilisation de cette fameuse baignoire. On racontait qu'untel y élevait des lapins, qu'un autre y cultivait des salades, qu'un troisième y logeait chaque soir une chèvre dont le lait alimentait ses enfants…
Des fenêtres étonnantes et … dangereuses :
En ces temps, lieux de délices pour nous autres enfants, la " baraque de carton " , de bois, de papier bitumé, avait en fait bien des défauts si on la compare aux logements d'aujourd'hui : L'hiver, il y faisait un froid glacial , seule la cuisine était chauffée par une minuscule cuisinière à charbon, et l'été, les soirs d'orage, il y faisait si chaud, que chacun redoutait l'heure d'aller se coucher.
Les fenêtres de ces baraques étaient étonnantes. Contrairement aux fenêtres françaises, elles s'ouvraient, ou plutôt s'entrouvraient sur l'extérieur. certaines d'entre elles équipées de vitres très grandes pour l'époque, se soulevaient comme des lucarnes, et il fallait les bloquer avec un système particulier pour laisser pénétrer l'air frais dans les pièces. Avec les années, les systèmes se détérioraient, et nombreux furent les locataires occupants, qui s'y écrasèrent en voulant les fermer.
Une hantise… le feu :
Quelques mètres seulement séparaient les baraques les unes des autres, et les matériaux dont elles étaient faites les rendaient extrêmement vulnérable au feu. La peur de l'incendie hantait toutes les familles qui surveillaient de très prés les enfants toujours enclins à jouer avec des allumettes. Malheur à celui qui était surpris à faire un "petit feu" dans le terrain vague voisin ! C'était la raclée paternelle assurée et la réprobation de tous les voisins… Même la traversée du champ de blé contigu au quartier, en plein mois de juin était une faute moins grave, et pourtant dans cette société issu du monde rural, ça coûtait très cher aux garçons insouciants que nous étions.
Au milieu des fleurs :
Chaque famille avait à cœur de rendre sa baraque avenante. Le long des fondations de pierres couraient de minuscules plates-bandes où les plants qui s'échangeaient entre voisins donnaient au printemps et en été de fort belles parures. Les familles qui habitaient sur le pourtour du quartier, et donc en bordure des talus, avaient pour la plupart aménagé de petits potagers et parfois même édifié des cabanons pour y ranger les outils et le charbon de la cuisinière.
Inutile, qu'elles étaient jalousées et de temps à autre certains parlaient d'aller dénoncer cette situation au "MRL", l'organisme qui gérait les baraques, sous le prétexte qu'en cas d'incendie, ces aménagements sauvages gêneraient les manœuvres des sapeurs-pompiers.
Un monde disparu :
Dans cette ville de bois que fut Brest entre 1945 et 1955, nous n'avions absolument pas l'impression d'être des marginaux.
La vie quotidienne y était tout à fait normale, et l'on s'habituait vite à cet environnement que l'on disait provisoire. Tout notre univers était en baraques : Les écoles, les églises, les commerces, et cela nous plaisait à nous les enfants, à tel point que lorsque vint le temps de quitter le quartier pour aller habiter les nouveaux immeubles de béton, pour la plupart d'entre nous, ce fut un déchirement qui se traduisit souvent dans les larmes.
Une nouvelle société urbaine naissait, et nous perdions un peu de nos racines
Emile Le Bourdiec, cet homme volubile, solidement planté, était scaphandrier en 1945. De ceux qui participèrent dans les années d'après guerre au relèvement des épaves encombrant le port et la rade de Brest. Ils ne sont plus que trois ou quatre à pouvoir évoquer cette épopée quotidienne.
Le travail réalisé par ces hommes a été non seulement titanesque, mais également un travail à hauts risques.
140 000 tonnes :
A l'époque " Les Abeilles ", pour le compte de laquelle travaillait Emile Le Bourdiec, était la compagnie la plus puissante. Elle ne fut pourtant pas la seule à travailler à la remise en route des ports de guerre et de commerce.
Le colossal chantier mobilisa aussi les compagnies "Neptune", "Océanique", "Charles de Marseille", éLa société Armoricaine de draguage", puis épisodiquement des Anglais et des Hollandais…
Le nettoyage du plan d'eau commença dés le mois de décembre 1944. On dénombra jusqu'à 600 épaves représentant 140 000 tonnes.
Il a fallu tout faire sauter :
Le dégagement progressif de la Penfeld fait partie des incontournables symboles de cette aventure. Plus encore que du renflouement du ponton-grue allemand Umbert (200 t) renversé prés du parc au ducs sous le château, ce sont les travaux effectués sur les deux volées du Pont National qui reviennent en mémoire.
" C'était un travail délicat qui a pris plusieurs mois. L'épave était très inclinée, profondément plantée. Il a fallu désolidariser les pièces à terre avant de procéder au découpage sous-marin. Quand on a posé les chaînes, quelque chose s'est cassé, l'envasement avait été sous-estimé. Je me souviens d'un collègue ému de voir au fond les réverbères du pont englouti. Cela faisait partie de notre passé, il a fallu tout faire sauter ".
En mars 1946, la Penfeld redevenait navigable, malgré la présence un peu plus en amont de l'épave de la nacelle du pont transbordeur et d'une montagne de filins d'acier, de vestiges de camions et de matériels militaires.
La mort de Montoya :
A la demande des autorités maritimes, qui souhaitaient y installer le "Jean Bart", le dégagement des bassins 8 et 9 fit également partie des priorités. " L'énorme épave d'un cargo mixte allemand de 200 m de long s'y trouvait. Il a aussi fallu remettre en état la porte du bassin et en dégager l'accès bloqué par des filets anti-torpilles ".
L'opération demanda plus d'un an de travail et coûta la vie au scaphandrier Montoya :
" Sa vitre de casque s'est dévissée au cours d'une descente. On travaillait dans des conditions difficiles, parfois par 35 m de fond, sans visibilité. Alors durant les élinguages, il fallait se méfier des serpents de filins d'acier se baladant entre deux eaux. De même en creusant des tunnels dans la vase, sous les épaves, nous prenions parfois des risques énormes ".
La rade propre en 1948 :
Le "Krosforn" à l'entrée de la passe sud, le "Waldeck Rousseau", la "Dordogne" prés de Roscanvel, la partie centrale du "Clémenceau" immergée par les Allemands, le Croiseur "Gueydon" qu'il fallut couper en trois, l' "Ockland" bâtiment Suédois transformé en navire hôpital et gisant prés du bassin des flottilles…
Dans le flot des souvenirs d'Emile Le Bourdiec, ce sont toutes les épaves qui reviennent à la surface du temps. " Souvent les coquilliers nous en signalaient la présence après avoir accroché leurs filets. Il m'est arrivé de tomber sans le vouloir sur une passerelle entière de navire. C'est vrai que quand on a fait ce que les scaphandriers d'alors ont fait, le reste est de la rigolade. On n'avait plus beaucoup de surprises professionnelles par la suite ".
Grâce à ces professionnels du risque, le port fut rapidement dégagé. Le 20 mars 1945 le "Paul Lemerle" immobilisait ses 4 000 tonneaux au cinquième bassin du port de commerce. Deux mois plus tard, c'était au tour du "Liberty Ship Carlson" d'y accoster. Petit à petit, les remous de la guerre s'estompaient. En 1948, la rade était déclarée " propre et complètement praticable " et le chantier de Brest dissous.
Le duo de la Reconstruction :
Mathon et Piquemal :
A ceux qui veulent comprendre l'histoire contemporaine de Brest, on ne saurait trop conseiller la lecture de " Brest alias Brest ", œuvre de plusieurs historiens locaux.
L'un d'eux, Yves Gallo, brosse dans cet ouvrage un petit portrait des deux hommes qui ont marqué la reconstruction : Maurice Piquemal et Jean-Baptiste Mathon.
Du premier ingénieur des Ponts et Chaussée il dit : " Tignasse en brosse compacte, sourcils et moustaches hérissés, geste chaleureux, regard jovial, faconde aquitaine, ce grand commis était un homme de cœur et de conscience très proche du petit peuple, à l'égard duquel il se reconnaissait le devoir de loger et de reloger en faisant vite.
En conséquence de quoi, s'accommodant de la médiocrité des crédits et des moyens, il établissait des records, fabriquant et superposant, sans reprendre haleine des km2 de plancher. Maurice Piquemal ne faisait pas ses délices de la lecture de Lamartine. Mais ce genre de dévergondage n'est pas fréquent dans le corps auquel il appartenait. Il lui sera donc beaucoup pardonné ".
" Ce sera moins le cas de l'urbaniste Jean Baptiste Mathon. Cet ancien combattant de la guerre 14, Grand prix de Rome déjà embaumé par les honneurs, condescendait parfois à quitter les bords de la Seine pour venir discuter dans la paisible préfecture de Quimper des affaires de Brest, qu'il n'accablait pas de ses visites ".
" On a cru devoir lui rendre un hommage qu'il ne méritait sans doute pas. Hommage ambigu : La plaque de marbre gravée à son nom a été placée au niveau du trottoir, si bien qu'elle semble réservée à la lecture et à la méditation des toutous baguenaudeurs dont notre ville n'est pas dépourvue. On ne saurait comparer la terne reconstruction de Brest à celle de Saint-Malo ".
Au bois de sapins ma maison était en carton :
Sinistrée à Recouvrance et réfugiée dans la presqu'île de Crozon pendant l'Occupation, ma famille est revenue habiter Brest en 1948. Une " baraque américaine " portant le N° B 12 lui avait été attribuée - enfin ! – dans un endroit appelé le "Bois-de-Sapins".
Ce petit quartier qui comptait une cinquantaine de baraques préfabriquées aux Etats-Unis avait été aménagé au milieu des champs, au fond d'une impasse (devenue la rue Théodore-Bothrel), accessible par la rue du commandant Drogou, la grande voie qui menait de Kérinou au Bergot.
Un excellent esprit régnait chez les habitants de ce village où la solidarité n'était pas un vain mot. " Nous nous connaissions tous car nous nous croisions sans arrêt dans les allées à une époque où l'on ne circulait pas en voiture et où la télévision ne nous confinait pas encore dans nos logements. Nous appartenions à des familles de petits fonctionnaires, d'officiers mariniers, d'ouvriers de l'arsenal ou du bâtiment.
Les parents étaient tous heureux de retrouver Brest après les années noires et de bénéficier de logements confortables pour l'époque en attendant de retrouver des maisons en dur ".
Ah, la belle baignoire ! :
Au Bois de sapins, nous avons le sentiment d'être des privilégiés, parce que nous habitons des baraques américaines.
Par rapport aux baraques dites Françaises ( mais étaient-elles vraiement de fabrication française?), nos petites maisons avaient la particularité de posséder une vraie salle de bains équipée d'une superbe baignoire émaillée, un luxe pour l'époque.
C'était une merveille que nous enviaient nos camarades des quartiers voisins de Kérédem, du Bergot ou du Bouguen.
Cette baignoire, il faut le reconnaître, était bien sûr fort commode pour la toilette, mais elle était surtout appréciée par les mères de famille qui pouvaient y faire la lessive sans sortir de chez elles.
Les plus folles rumeurs couraient sur l'utilisation de cette fameuse baignoire. On racontait qu'untel y élevait des lapins, qu'un autre y cultivait des salades, qu'un troisième y logeait chaque soir une chèvre dont le lait alimentait ses enfants…
Des fenêtres étonnantes et … dangereuses :
En ces temps, lieux de délices pour nous autres enfants, la " baraque de carton " , de bois, de papier bitumé, avait en fait bien des défauts si on la compare aux logements d'aujourd'hui : L'hiver, il y faisait un froid glacial , seule la cuisine était chauffée par une minuscule cuisinière à charbon, et l'été, les soirs d'orage, il y faisait si chaud, que chacun redoutait l'heure d'aller se coucher.
Les fenêtres de ces baraques étaient étonnantes. Contrairement aux fenêtres françaises, elles s'ouvraient, ou plutôt s'entrouvraient sur l'extérieur. certaines d'entre elles équipées de vitres très grandes pour l'époque, se soulevaient comme des lucarnes, et il fallait les bloquer avec un système particulier pour laisser pénétrer l'air frais dans les pièces. Avec les années, les systèmes se détérioraient, et nombreux furent les locataires occupants, qui s'y écrasèrent en voulant les fermer.
Une hantise… le feu :
Quelques mètres seulement séparaient les baraques les unes des autres, et les matériaux dont elles étaient faites les rendaient extrêmement vulnérable au feu. La peur de l'incendie hantait toutes les familles qui surveillaient de très prés les enfants toujours enclins à jouer avec des allumettes. Malheur à celui qui était surpris à faire un "petit feu" dans le terrain vague voisin ! C'était la raclée paternelle assurée et la réprobation de tous les voisins… Même la traversée du champ de blé contigu au quartier, en plein mois de juin était une faute moins grave, et pourtant dans cette société issu du monde rural, ça coûtait très cher aux garçons insouciants que nous étions.
Au milieu des fleurs :
Chaque famille avait à cœur de rendre sa baraque avenante. Le long des fondations de pierres couraient de minuscules plates-bandes où les plants qui s'échangeaient entre voisins donnaient au printemps et en été de fort belles parures. Les familles qui habitaient sur le pourtour du quartier, et donc en bordure des talus, avaient pour la plupart aménagé de petits potagers et parfois même édifié des cabanons pour y ranger les outils et le charbon de la cuisinière.
Inutile, qu'elles étaient jalousées et de temps à autre certains parlaient d'aller dénoncer cette situation au "MRL", l'organisme qui gérait les baraques, sous le prétexte qu'en cas d'incendie, ces aménagements sauvages gêneraient les manœuvres des sapeurs-pompiers.
Un monde disparu :
Dans cette ville de bois que fut Brest entre 1945 et 1955, nous n'avions absolument pas l'impression d'être des marginaux.
La vie quotidienne y était tout à fait normale, et l'on s'habituait vite à cet environnement que l'on disait provisoire. Tout notre univers était en baraques : Les écoles, les églises, les commerces, et cela nous plaisait à nous les enfants, à tel point que lorsque vint le temps de quitter le quartier pour aller habiter les nouveaux immeubles de béton, pour la plupart d'entre nous, ce fut un déchirement qui se traduisit souvent dans les larmes.
Une nouvelle société urbaine naissait, et nous perdions un peu de nos racines
Logico- Major

- Nombre de messages : 113
Age : 99
Date d'inscription : 31/07/2006
 La Libération de Brest
La Libération de Brest
Souvenirs et Commentaires personnels :
" Je ne puis quitter Brest, sans évoquer ici, ce que cette ville évoque pour moi.
D'abord, c'est le premier port que j'ai vu dans mon enfance ? J'avais treize ans, lorsque j'y suis arrivé. Après Rennes, c'est la deuxième grande ville que je découvrais.
Lorsque avec mes parents j'y suis arrivé en 1938, cela s'est fait par le train, que j'avais donc pris pour la première fois à Rennes. Je me suis alors retrouvé dans cette ville inconnue. Pour mes treize ans, c'était comme la découverte d'un nouveau monde.
Pour moi jusqu'alors, le monde s'arrêtait autour de Brais, Vieux Vy sur Cousesnom, Chauvigné, Saint Marc le Blanc, Tremblay, Saint Brice en Cogles, Sens de Bretagne et quelque fois Rennes pour changer mes lunettes.
Par contre de Brais à Chauvigné est une route que j'ai souvent faite à pieds et en sabots à collets, pour aller à l'école. J'y ai également souvent pris les raccourcis par les champs. C'est dire que ce petit monde, je le connaissais bien.
Brest a pour moi été quelque chose de nouveau dans ma vie. D'abord l'Ecole Primaire Supérieure de la Place Wilson, où je suis allé un an et demi, puis l'Arsenal de Brest où je suis entré après concours d'entrée comme apprenti technicien.
Pour mon transport, je n'avais pas changé mes habitudes, toujours à pieds, mais avec des chaussures cette fois. (finis les sabots)
Pour les vacances scolaires, j'ai passé les premières comme "Chasseur" dans un grand hôtel, les suivantes comme commissionnaire de la Mairie de Saint-Marc (prés de Brest), où nous habitions, puis comme porteur de télégrammes à Saint Marc et à Brest. Ce que j'étais d'ailleurs au moment de la déclaration de Guerre en 1939.
Je puis dire que j'ai bien arpenté le terrain à cette époque en vélo (fourni par la mairie), et que j'en connaissais parfaitement la topographie.
Puis un jour : " Surprise " : Un bruit de bottes dans la rue du capitaine Guynemer où nous habitions. Je vois encore Papa se lever et regarder au travers des fentes des volets. Une patrouille Allemande passait dans la rue, alors que la veille on nous annonçait à la radio que l'armée Française se battait victorieusement contre eux dans le Nord.
Sa première phrase fut : " Merde. Les Boches ". Il était tout pâle et n'en croyait pas ses yeux. Je reverrai toujours le regard qu'il échangea avec Maman. Dans ce regard, passa beaucoup de souvenirs de la guerre de 14-18 qu'il avait vécu à Verdun dans les " Crapouillots.
Après la déclaration de guerre, et après mes vacances, (si on peut appeler cela ainsi), je suis donc allé travailler à l'arsenal de Brest, toujours à pied, mais souvent, sous les bombardements et sous la mitraille, me faufilant de seuil d'entrée en seuil d'entrée pendant les attaques d'avions anglais.
Puis, un jour, Papa a décidé que nous devions revenir à Brais, les risques devenant trop grands pour aller au travail. Notre lieu d'habitation situé à côté du "Fort du "Guelmeur" était devenu un lieu à hauts risques également. Je reprenais donc le train pour la seconde fois, mais cette fois, pour revenir dans un endroit que je connaissais bien.
Quinze jours après que nous avions quitté, une bombe tombait sur le pavillon où nous avions habité. Pas de regrets de ne pas être restés. Papa ne s'était pas trompé.
Je suis retourné à Brest une trentaine d'années plus tard (dans les années 70 à 75 ). Je n'ai plus retrouvé le Brest plein de vie que j'avais connu, celui où lorsqu'on se promenait rue de Siam les jours de bruines (crachin), il fallait faire attention à ses yeux ou porter des lunettes pour ne pas risquer de se faire éborgner par les baleines de parapluies.
Par contre, j'ai pu remonter par la rue Yves Collet, ainsi que par la rue Jean Jaurès (deux rues parallèles) que j'ai bien parcourue à pieds comme en vélo (soit l'une, soit l'autre) pour faire le trajet de Saint-Marc à Brest et vice-versa.
Si je n'ai pas retrouvé le Brest que j'avais connu, j'ai par compte bien retrouvé le "Guelmeur" sans problèmes par la topographie des lieux, mais avec des pentes beaucoup moins accentuées que de mon jeune temps.
Elles avaient été sérieusement nivelée par les bombes, puis par les "bulldozers".
J'avais retrouvé Brest, une ville que j'ai aimée, une ville dont j'ai gardé d'excellents souvenirs : La rue de Siam où j'aimais me promener pour passer ensuite sur le Pont National et regarder passer les bateaux. Le quartier de Recouvrance, où nous avions des amis Mr et Mme Pizzin et leurs enfants avec lesquels, maintes fois j'ai eu l'occasion de jouer. Le quartier de la Gare par où je passais pour aller à l'école Place Wilson, trajet sur lequel je trouvais plusieurs camarades de classe. Le quartier de Lambézellec par où je passais pour aller à l'Arsenal, trajet qui est resté à jamais gravé dans ma mémoire avec l'époque, où il fallait jouer à "cache cache" avec les attaques d'avions en piqué.
Mais je n'ai pas retrouvé la ville de mon enfance. Je n'y suis jamais retourné depuis et n'en ai pas éprouvé le besoin. Par contre, je ne dis pas qu'un jour …
Ces lignes écrites sur Brest m'ont ramené en arrière, et je ne puis que rendre un grand hommage au courage de tous ceux qui ont vécu tout cela, sans oublier d'adresser un grand merci à tous ceux qui ont permis de mettre fin à cet épisode cauchemardesque qu'à été cette époque et que je souhaite révolue à tout jamais ".
Roger Lenevette
( Allias JEANNOT . Matricile 10.698 )
(Logico pour le Forum)
" Je ne puis quitter Brest, sans évoquer ici, ce que cette ville évoque pour moi.
D'abord, c'est le premier port que j'ai vu dans mon enfance ? J'avais treize ans, lorsque j'y suis arrivé. Après Rennes, c'est la deuxième grande ville que je découvrais.
Lorsque avec mes parents j'y suis arrivé en 1938, cela s'est fait par le train, que j'avais donc pris pour la première fois à Rennes. Je me suis alors retrouvé dans cette ville inconnue. Pour mes treize ans, c'était comme la découverte d'un nouveau monde.
Pour moi jusqu'alors, le monde s'arrêtait autour de Brais, Vieux Vy sur Cousesnom, Chauvigné, Saint Marc le Blanc, Tremblay, Saint Brice en Cogles, Sens de Bretagne et quelque fois Rennes pour changer mes lunettes.
Par contre de Brais à Chauvigné est une route que j'ai souvent faite à pieds et en sabots à collets, pour aller à l'école. J'y ai également souvent pris les raccourcis par les champs. C'est dire que ce petit monde, je le connaissais bien.
Brest a pour moi été quelque chose de nouveau dans ma vie. D'abord l'Ecole Primaire Supérieure de la Place Wilson, où je suis allé un an et demi, puis l'Arsenal de Brest où je suis entré après concours d'entrée comme apprenti technicien.
Pour mon transport, je n'avais pas changé mes habitudes, toujours à pieds, mais avec des chaussures cette fois. (finis les sabots)
Pour les vacances scolaires, j'ai passé les premières comme "Chasseur" dans un grand hôtel, les suivantes comme commissionnaire de la Mairie de Saint-Marc (prés de Brest), où nous habitions, puis comme porteur de télégrammes à Saint Marc et à Brest. Ce que j'étais d'ailleurs au moment de la déclaration de Guerre en 1939.
Je puis dire que j'ai bien arpenté le terrain à cette époque en vélo (fourni par la mairie), et que j'en connaissais parfaitement la topographie.
Puis un jour : " Surprise " : Un bruit de bottes dans la rue du capitaine Guynemer où nous habitions. Je vois encore Papa se lever et regarder au travers des fentes des volets. Une patrouille Allemande passait dans la rue, alors que la veille on nous annonçait à la radio que l'armée Française se battait victorieusement contre eux dans le Nord.
Sa première phrase fut : " Merde. Les Boches ". Il était tout pâle et n'en croyait pas ses yeux. Je reverrai toujours le regard qu'il échangea avec Maman. Dans ce regard, passa beaucoup de souvenirs de la guerre de 14-18 qu'il avait vécu à Verdun dans les " Crapouillots.
Après la déclaration de guerre, et après mes vacances, (si on peut appeler cela ainsi), je suis donc allé travailler à l'arsenal de Brest, toujours à pied, mais souvent, sous les bombardements et sous la mitraille, me faufilant de seuil d'entrée en seuil d'entrée pendant les attaques d'avions anglais.
Puis, un jour, Papa a décidé que nous devions revenir à Brais, les risques devenant trop grands pour aller au travail. Notre lieu d'habitation situé à côté du "Fort du "Guelmeur" était devenu un lieu à hauts risques également. Je reprenais donc le train pour la seconde fois, mais cette fois, pour revenir dans un endroit que je connaissais bien.
Quinze jours après que nous avions quitté, une bombe tombait sur le pavillon où nous avions habité. Pas de regrets de ne pas être restés. Papa ne s'était pas trompé.
Je suis retourné à Brest une trentaine d'années plus tard (dans les années 70 à 75 ). Je n'ai plus retrouvé le Brest plein de vie que j'avais connu, celui où lorsqu'on se promenait rue de Siam les jours de bruines (crachin), il fallait faire attention à ses yeux ou porter des lunettes pour ne pas risquer de se faire éborgner par les baleines de parapluies.
Par contre, j'ai pu remonter par la rue Yves Collet, ainsi que par la rue Jean Jaurès (deux rues parallèles) que j'ai bien parcourue à pieds comme en vélo (soit l'une, soit l'autre) pour faire le trajet de Saint-Marc à Brest et vice-versa.
Si je n'ai pas retrouvé le Brest que j'avais connu, j'ai par compte bien retrouvé le "Guelmeur" sans problèmes par la topographie des lieux, mais avec des pentes beaucoup moins accentuées que de mon jeune temps.
Elles avaient été sérieusement nivelée par les bombes, puis par les "bulldozers".
J'avais retrouvé Brest, une ville que j'ai aimée, une ville dont j'ai gardé d'excellents souvenirs : La rue de Siam où j'aimais me promener pour passer ensuite sur le Pont National et regarder passer les bateaux. Le quartier de Recouvrance, où nous avions des amis Mr et Mme Pizzin et leurs enfants avec lesquels, maintes fois j'ai eu l'occasion de jouer. Le quartier de la Gare par où je passais pour aller à l'école Place Wilson, trajet sur lequel je trouvais plusieurs camarades de classe. Le quartier de Lambézellec par où je passais pour aller à l'Arsenal, trajet qui est resté à jamais gravé dans ma mémoire avec l'époque, où il fallait jouer à "cache cache" avec les attaques d'avions en piqué.
Mais je n'ai pas retrouvé la ville de mon enfance. Je n'y suis jamais retourné depuis et n'en ai pas éprouvé le besoin. Par contre, je ne dis pas qu'un jour …
Ces lignes écrites sur Brest m'ont ramené en arrière, et je ne puis que rendre un grand hommage au courage de tous ceux qui ont vécu tout cela, sans oublier d'adresser un grand merci à tous ceux qui ont permis de mettre fin à cet épisode cauchemardesque qu'à été cette époque et que je souhaite révolue à tout jamais ".
Roger Lenevette
( Allias JEANNOT . Matricile 10.698 )
(Logico pour le Forum)
Logico- Major

- Nombre de messages : 113
Age : 99
Date d'inscription : 31/07/2006
 Re: La Libération de Brest
Re: La Libération de Brest
Héla Jeannot, tu veux la mort de nos pauvre yeux ??? :lol:
Merci beaucoup, je vais prendre un réel plaisir à lire tout ceci (pendant le cours de Math :lol:)
Ivy
Merci beaucoup, je vais prendre un réel plaisir à lire tout ceci (pendant le cours de Math :lol:)
Ivy
_________________

___________________________________________
TOGETHER WE CAN ACTUALLY MAKE A DIFFERENCE
www.ifaw.org
International Fund for Animal Welfare
Le monde animal a besoin de nous !

Ivy mike- Général (Administrateur)

- Nombre de messages : 9350
Date d'inscription : 16/06/2005
 Re: La Libération de Brest
Re: La Libération de Brest
toujours un vrais plaisir de te lire Logico... 


Charlemagne- Police militaire (Modérateur)

- Nombre de messages : 4794
Age : 36
Localisation : Montpellier
Date d'inscription : 11/02/2006
 Re: La Libération de Brest
Re: La Libération de Brest
Bonjour,
Très intéressant sujet (...et une pensée particulière pour son auteur).
il y a, toutefois. une petite correction à apporter concernant le débarquement de la 2e DB évoqué ici:
"Le gâchis de la reconstruction :
Le 6 juin 1944, alors qu'il débarquait sur les plages de Normandie avec les troupes de la 2ème D.B. du général Leclerc, M.D. (qui a souhaité garder l'anonymat), avait d'autres préoccupations que sa ville natale à la pointe du finistère....."
La 2e DB n'a débarqué à Utah Beach qu'a partir du 1er Août 44.
Kénavo,
Pierre
Très intéressant sujet (...et une pensée particulière pour son auteur).
il y a, toutefois. une petite correction à apporter concernant le débarquement de la 2e DB évoqué ici:
"Le gâchis de la reconstruction :
Le 6 juin 1944, alors qu'il débarquait sur les plages de Normandie avec les troupes de la 2ème D.B. du général Leclerc, M.D. (qui a souhaité garder l'anonymat), avait d'autres préoccupations que sa ville natale à la pointe du finistère....."
La 2e DB n'a débarqué à Utah Beach qu'a partir du 1er Août 44.
Kénavo,
Pierre
SALIOU Pierre- Capitaine

- Nombre de messages : 240
Age : 71
Localisation : Bretagne
Date d'inscription : 21/11/2010
 Sujets similaires
Sujets similaires» combats pour la libération de Brest
» Mémoires des Résistants et FFI du pays de Brest
» La liberation de Paris
» En France sous l'occupation
» Actualités concernant les archives et centres de documentation
» Mémoires des Résistants et FFI du pays de Brest
» La liberation de Paris
» En France sous l'occupation
» Actualités concernant les archives et centres de documentation
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum