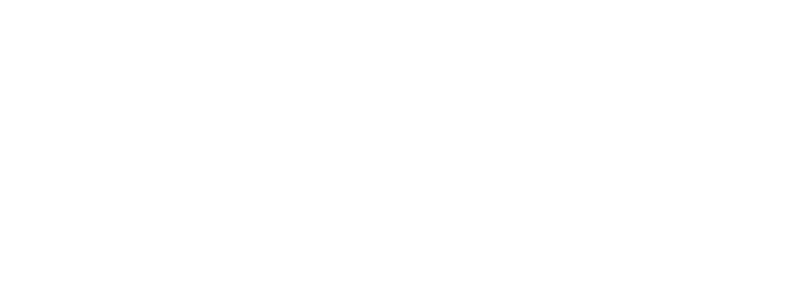Homme ou bête : Réflexion sur le statut du déporté (P-Kuon)
Page 1 sur 1
 Homme ou bête : Réflexion sur le statut du déporté (P-Kuon)
Homme ou bête : Réflexion sur le statut du déporté (P-Kuon)
Une reflexion intéressante sur le statut des déportés dans les camps de concentrations nazis par Peter Kuon.
1ère PARTIE :
BIBLIOGRAPHIE 1ERE PARTIE :
(1) Pierre Daix, La dernière forteresse, Paris, Éditeurs Français Réunis - Amicale de Mauthausen, 1950, p. 393.
(2) Roger Gouffault, Quand l’homme sera-t-il humain, Brive, Écritures, 2003, p. 10.
(3) Suzanne Wilborts, Pour la France, Limoges-Paris-Nancy, Charles-Lavauzelle, 1946, p. 45.
(4) Émile et Paul Le Caer, KL Mauthausen. Les cicatrices de la mémoire, Bayeux, Heimdal, 1996, p. 31.
(5) Louis Buton, Un vendéen résistant et déporté, La Crèche, Geste éditions, 2003, p. 127 ; Louis Balsan, Le ver luisant, Issoudun, Gaignault Éditeur, 1973, p. 44 ; Andrée François, Passeurs et déportés (N.N.), Pont-à-Mousson,
P. Franois - Amicale de Mauthausen, 1990, p. 23.
(6) Pierre Saint Macary, Mauthausen, percer l’oubli. Mauthausen, Melk, Ebensee, Paris, L’Harmattan, 2004, p. 15.
(7) Gilbert Debrise, Cimetières sans tombeaux, Paris,
La Bibliothèque Française, 1946, p. 53.
(8) Pierre Saint Macary, op.cit., p. 17.
(9) Paul Brusson, De mémoire vive, Liège, Éditions du Céfal, 2003, p. 88.
(10) Suzanne Wilborts, op.cit., p. 96.
(11) Gilbert Debrise, op.cit., p. 113.
(12) Georges Loustaunau-Lacau, Chiens maudits. Souvenirs d’un rescapé des bagnes hitlériens, Paris, Éditions du réseau Alliance, 1960, p. 31.
(13) Ibid., p. 51.
(14) Roger Heim, La sombre route, Paris, Corti, 1947, p. 43.
(15) René Gille, Au delà de l’inhumain, s.l., s.a. [1948], p. 52.
(16) François Wetterwald, Les morts inutiles, Paris, Minuit, 1946, p. 51.
(17) Gilbert Debrise, op.cit., p. 113.
(18) Suzanne Wilborts, op.cit., p. 96.
(19) Paolo Liggeri, Triangolo rosso. Dalle carceri di San Vittore ai campi di concentramento e di eliminazione di Fossoli, Bolzano, Mauthausen, Gusen, Dachau. Marzo 1944 - Maggio1945, Milano, La Casa, 1946, p. 387 (ma traduction).
(20) Paul Brusson, op.cit., pp. 72 et 74.
(21) Jean Degroote, Prisons de la Gestapo et camps de concentration, Steenvoorde, Foyer culturel de l’Houtland, 1995, pp. 54-55.
1ère PARTIE :
Homme ou bête : Les réflexions sur le statut du déporté dans le récit concentrationnaire
(par Peter Kuon, Directeur de l’Institut d’Etudes Romane Université de Salzbourg - Colloques de Nantes 2006)
Vers la fin de "La dernière forteresse", roman sur Mauthausen de Pierre Daix, publié en 1950, le personnage principal, André, propose une définition du héros : « Je crois qu’un héros, c’est un homme qui a bien fait son boulot d’homme, quand ça n’était pas simple de le faire » (1). Cet emploi métaphorique du terme de boulot met en parallèle le travail corporel et l’effort moral d’agir dans les limites d’une idée de l’homme, héritée de la tradition millénaire de l’humanisme européen. Mais comment bien faire un boulot, si les conditions de travail ne le permettent pas ? Et comment vivre selon les normes humanistes, si les conditions de vie sont profondément inhumaines ?
Le travail concentrationnaire, qui est au centre du congrès 2007 de l’Amicale de Mauthausen, n’est, dans cette perspective, qu’un élément de plus pour mettre à l’épreuve l’humanité des déportés. Ce qui m’intéresse, dans cette communication, c’est la réflexion sur cette mise à l’épreuve dans les textes mêmes des survivants. En cela, mon approche se distingue de l’abstraction des discours philosophiques ou politiques qui discutent le problème de la condition humaine dans les camps, en privilégiant telle ou telle catégorie de déportés : les juifs, les résistants, les femmes, les musulmans etc. Et elle se distingue aussi de l’élitarisme de la critique littéraire qui ne prend en considération que les textes canoniques des grands auteurs tels que Wiesel, Levi, Semprun ou Kértesz. Après plusieurs années de recherches sur les écrits des survivants de Mauthausen, je suis de plus en plus convaincu de l’immense valeur des témoignages, si nous voulons maintenir, dans un futur sans témoins, une mémoire vive - non sommaire, mais circonstanciée et différenciée - de l’expérience concentrationnaire. L’avantage de l’écrit, dans l’acte de témoigner, est qu’il demande du temps à l’auteur et au lecteur - le temps de la réflexion. Pour le dire avec Roger Gouffault : "L’écrit reste. L’écrit est une trace, tandis que les paroles s’envolent. Le livre, qui est un écrit long, permet de prendre le temps. Démontrer la progression, l’évolution des choses. Et donc de les comprendre " (2).
Afin de comprendre “le boulot d’homme” du déporté, il faut réfléchir au “boulot de bête” qu’on lui inflige.
La métamorphose de l’homme en bête se fait au moment de l’arrivée au camp, véritable rite de passage, soigneusement mis en scène par les nazis : l’attente interminable sur la place d’appel, sous le soleil ou dans la neige, l’abandon des bagages, la perte des objets personnels, le déshabillage, le rasage de la tête aux pieds, la désinfection, la douche, la distribution de vêtements et de galoches, encore une fois l’attente et, finalement, l’admission aux baraques de quarantaine. En lisant les témoignages, on s’aperçoit du désarroi des nouveaux venus qui, au bout de quelques heures, ne se reconnaissent plus, ni comme individus ni comme êtres humains. Voilà comment Suzanne Wilborts, libérée à Mauthausen, décrit l’aspect de ses compagnes après l’immatriculation à Ravensbrück : ".Elles sortent de là, transformées, avec de pauvres robes en loques, les pieds nus, les cheveux trempés, pendant lamentablement. Elles marchent comme des canards, en traînant leurs semelles de bois. Un groupe est complètement passé à la tondeuse, elles sont affreuses " (3). On comprend que l’auteur, en 1946, se trouve toujours sous le choc des événements.
Mais Paul Le Caer, cinquante ans après, ne réussit pas encore à tenir à distance ses souvenirs traumatisants : "Douche, désinfection, c’est terminé. Vous n’êtes plus un homme mais un numéro qui deviendra bientôt un sous-homme ou un morceau (Stück). Ce passage dans les baraques ou blocs de quarantaine a pour but la déshumanisation des hommes, chacun d’eux doit perdre sa personnalité, son identité, pour devenir un fauve numéroté parmi les bêtes, se battant pour manger plus que son voisin " (4). Le Caer revit au présent les détails humiliants de l’accueil à Mauthausen, avant d’expliquer à tête reposée le but de l’opération : la déshumanisation des hommes.
“Fauve numéroté” ou “canard”..., le déporté ou la déportée est souvent comparé, après sa transformation en ‘Häftling’ (détenu), à des animaux. On ne s’étonnerait pas de trouver des comparaisons animales dans les paroles rapportées des kapos. Le fait de les rencontrer dans la voix narrative des témoignages prouve cependant qu’elles correspondent à l’auto-perception de bien des déportés qui se souviennent d’avoir été “nus comme des vers” (5), d’avoir lapé leur soupe, le premier jour, “comme des chiens” (6), de s’être bousculés, le matin, “comme des boeufs à l’abreuvoir” (7), de s’être défendus contre le froid comme un “troupeau”, en s’agglutinant « les uns contre les autres, debout “en boule” » (8) ou « “en grappe” » (9). À partir du moment où, une fois sortis de quarantaine, les détenus commencent à travailler dans les différents “kommandos”, ils se voient souvent comme « bêtes de somme » (10), « bêtes humaines » (11), « animaux de charge, de trait » (12), « bétail humain » (13) ou, dans une perspective panoramique sur les lieux de travail, comme des “termites” (14) ou des “ (” (15). François Wetterwald compare le cortège de 2000 hommes descendant la route vers la carrière de Mauthausen à « une immense chenille ondulant au rythme du pas cadencé par les “capos” » (16).
Quelle est la fonction d’un langage qui, semble-t-il, confirme après coup la réussite de l’opération de déshumanisation ? En premier lieu, il s’agit, de donner au lecteur, par les comparaisons animales, une idée approchante des conditions de vie et de travail dans un camp de concentration ou, pour être plus précis, dans un camp de la mort lente. C’est ainsi que Gilbert Debrise, en distinguant deux catégories de détenus dans un camp, celle des maîtres et celle des esclaves, compare les derniers, c’est-à-dire la grande masse des détenus, à des bêtes, afin de mettre en évidence leur situation encore plus misérable : « Les esclaves sont moins que des bêtes. Les bêtes ont une valeur marchande. Le paysan qui les élève s’y intéresse, les entoure de soins et d’égards. Ici les bêtes humaines, qu’on importe par trains entiers, représentent une marchandise gratuite » (17).
Il me semble pourtant qu’à l’emploi des comparaisons animales, au su et à l’insu des auteurs, revient une seconde fonction. J’y vois la trace du doute que Primo Levi formule dans le titre de son premier récit de déportation : "Se questo è un uomo "(Si c’est un homme). Des êtres humains traités de bêtes risquent, tôt ou tard, de devenir des bêtes. En général, les bêtes sont les autres : « Ce ne sont plus des femmes mais des bêtes de somme, dont le temps de rendement ne dépasse guère six mois pour les plus solides » (18). Paolo Liggeri, un prêtre italien, décrit ainsi l’arrivée à Mauthausen d’un transport venu des camps d’extermination de l’Est : « La place grouillant de spectres résonne d’un bruit étrange, sourd et terrible, comme une sarabande fantasmatique de squelettes mobiles [...]. Et pourtant, ce sont des hommes, des hommes... Non, en réalité c’étaient des hommes. Maintenant, ils ne le sont plus, ils sont morts ; même s’ils respirent encore, ils ne sont plus des hommes. Et ils ne sont même pas des bêtes, puisque alors ils seraient mieux traités. Qui pourrait dire ce qu’ils sont ? » (19). Le regard jeté sur les autres, ceux qui ne sont plus des hommes et moins que des bêtes et qu’on appelle dans beaucoup de camp des musulmans, rassure l’observateur sur sa propre appartenance au genre humain. En même temps, les réflexions assez fréquentes sur le musulman indiquent l’angoisse de basculer un jour ou l’autre dans la catégorie des morts vivants : « Je suis si mal en point que, si cette situation dure, je serai bientôt considéré comme Muselman » (20). Rares sont pourtant les auteurs qui avouent, comme Jean Degroote, leur propre déchéance : « Je n’en peux plus ; je n’en ai plus pour longtemps à vivre ; d’ailleurs j’en ai assez, je n’ai plus le moral, je ne veux pas mourir, je veux crever, on ne meurt pas à Linz, on crève, comme des bêtes que nous sommes tous devenus, c’était leur but, ils l’ont atteint, nous sommes des bêtes » (21).
BIBLIOGRAPHIE 1ERE PARTIE :
(1) Pierre Daix, La dernière forteresse, Paris, Éditeurs Français Réunis - Amicale de Mauthausen, 1950, p. 393.
(2) Roger Gouffault, Quand l’homme sera-t-il humain, Brive, Écritures, 2003, p. 10.
(3) Suzanne Wilborts, Pour la France, Limoges-Paris-Nancy, Charles-Lavauzelle, 1946, p. 45.
(4) Émile et Paul Le Caer, KL Mauthausen. Les cicatrices de la mémoire, Bayeux, Heimdal, 1996, p. 31.
(5) Louis Buton, Un vendéen résistant et déporté, La Crèche, Geste éditions, 2003, p. 127 ; Louis Balsan, Le ver luisant, Issoudun, Gaignault Éditeur, 1973, p. 44 ; Andrée François, Passeurs et déportés (N.N.), Pont-à-Mousson,
P. Franois - Amicale de Mauthausen, 1990, p. 23.
(6) Pierre Saint Macary, Mauthausen, percer l’oubli. Mauthausen, Melk, Ebensee, Paris, L’Harmattan, 2004, p. 15.
(7) Gilbert Debrise, Cimetières sans tombeaux, Paris,
La Bibliothèque Française, 1946, p. 53.
(8) Pierre Saint Macary, op.cit., p. 17.
(9) Paul Brusson, De mémoire vive, Liège, Éditions du Céfal, 2003, p. 88.
(10) Suzanne Wilborts, op.cit., p. 96.
(11) Gilbert Debrise, op.cit., p. 113.
(12) Georges Loustaunau-Lacau, Chiens maudits. Souvenirs d’un rescapé des bagnes hitlériens, Paris, Éditions du réseau Alliance, 1960, p. 31.
(13) Ibid., p. 51.
(14) Roger Heim, La sombre route, Paris, Corti, 1947, p. 43.
(15) René Gille, Au delà de l’inhumain, s.l., s.a. [1948], p. 52.
(16) François Wetterwald, Les morts inutiles, Paris, Minuit, 1946, p. 51.
(17) Gilbert Debrise, op.cit., p. 113.
(18) Suzanne Wilborts, op.cit., p. 96.
(19) Paolo Liggeri, Triangolo rosso. Dalle carceri di San Vittore ai campi di concentramento e di eliminazione di Fossoli, Bolzano, Mauthausen, Gusen, Dachau. Marzo 1944 - Maggio1945, Milano, La Casa, 1946, p. 387 (ma traduction).
(20) Paul Brusson, op.cit., pp. 72 et 74.
(21) Jean Degroote, Prisons de la Gestapo et camps de concentration, Steenvoorde, Foyer culturel de l’Houtland, 1995, pp. 54-55.
 Re: Homme ou bête : Réflexion sur le statut du déporté (P-Kuon)
Re: Homme ou bête : Réflexion sur le statut du déporté (P-Kuon)
2EME PARTIE :
BIBLIOGRAPHIE 2EME PARTIE :
(22) Jean Laffitte, Ceux qui vivent, Paris, Éditions Hier
et Aujourd’hui, 1947.
(23) Roger Heim, op.cit., p. 19.
(24) Bruno Bettelheim, « Comportement individuel et comportement de masse dans les situations extrêmes » (1943), in : B.B., Survivre, Paris, Robert Laffont, 1979, pp. 66-105, ivi p. 83.
(25) Paul Tillard, Mauthausen, Paris, Éditions Sociales, 1945,
p. 62.
(26) Marie-Jo Chombart de Lauwe, Toute une vie de résistance, Paris, Graphein-FNDIRP, 1998 (écrit 1945) p. 60
[Marie-Jo Chombart de Lauwe est la fille de Suzanne Wilborts].
(27) Ibid., p. 62.
(28) Ibid., p. 86.
(29) Ibid.
(30) Ibid., p. 96.
(31) Roger Gouffault, op.cit., p. 122.
(32) René Gille, op.cit., p. 79.
(33) Jean Varnoux, Clartés dans la nuit. La résistance de l’esprit. Journal d’un prêtre déporté, Naves, Éditions de
La Veytizou, 1995, p. 246.
(34) François Wetterwald, op.cit., p. 179.
(35) Ibid., pp. 175-176.
(36) Ibid., p. 176.
(37) Gilbert Debrise, op.cit., p. 187.
(38) René Gille, op.cit., p. 83.
(39) Hannah Arendt, « Die Konzentrationslager », in : H.A., Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, totale Herrschaft, Frankfurt/M., Fischer 102005 (1951), pp. 907-943, ivi p. 908 (ma traduction).
(40) Jean Degroote, op.cit., pp. 56-57.
(41) André Malavoy, La mort attendra. Souvenirs de guerre, Paris-Montréal, Les Éditions de l’Homme, 1961, p. 108.
(42) Emmanuel Lévinas, Humanisme de l’autre homme, Paris, Fata Morgana, 1972, p. 105.
Si, d’une part, les survivants décrivent leur statut dans le camp comme celui de bêtes, ils insistent, d’autre part, sur leur refus d’accepter le mode d’existence qu’on leur octroie. Quelles sont les stratégies de défense des détenus ? Ceux qui se souviennent d’avoir ignoré ou refoulé l’humiliation subie, sont une minorité. Jean Laffitte, dans "Ceux qui vivent", publié en 1947, raconte que son groupe a vécu le moment de la “métamorphose” avec des éclats de rire (22). Cette réaction souligne en rétrospective la stabilité psychique des politiques qui, par leur rire, arrivent à bannir ce qui pourrait les traumatiser et, par là même, à déjouer la stratégie des nazis. La plupart des détenus semble réagir par un mouvement psychologique qui consiste à séparer le moi concentrationnaire du moi véritable, du moi authentique : « J’étais un Untermensch, pas même, un animal numéroté et marqué à la tondeuse, voué à la destruction par la mort lente. Celui qui avait porté mon nom, ma personnalité définie, précise, n’était plus là, dans ce camp. Il était conservé là-bas, bien loin, très loin, à l’ouest, dans le souvenir vivant des miens et de mes amis » (23) Bruno Bettelheim analyse cette dissociation comme un mécanisme protecteur qui permettait au détenu de s’adapter au système concentrationnaire, sans engager son moi identitaire. L’attitude du détenu peut se résumer ainsi : « Ce que je fais ici, ou ce qui est en train de m’arriver, ne compte absolument pas ; ici, tout est permis à condition que (et dans la mesure où) ça m’aide à survivre » (24). Bettelheim a été beaucoup critiqué pour l’hypothèse de l’adaptation totale du détenu au système de valeurs des camps. À mon avis, il a eu raison de mettre en évidence un raisonnement qui pouvait justifier les pires égoïsmes. « Combien d’hommes dont la vie avait été jusqu’alors un exemple d’honnêteté ont volé le pain de leur camarade. Cela faisait partie de la déchéance morale voulue par les nazis. C’était le dernier acte, en dehors de toute conscience, d’une vitalité qui ne voulait pas mourir » (25). Le prix à payer pour la survie physique est, dans ces cas-là, l’abandon de la personne morale. La réaction contraire, à savoir le maintien de l’intégrité morale et le refus de tout compromis, aurait rendu la survie impossible. D’une façon ou d’une autre, il fallait donc s’adapter, tout en se ménageant un espace intérieur où puiser la force d’une résistance au système concentrationnaire. Pour la majorité non des survivants mais des déportés cet espace identitaire, fondateur de petits actes d’affirmation de soi, de solidarité avec les autres, voire de résistance, se rétrécissait au fil des jours comme une peau de chagrin.
Prenons un exemple : Marie-Jo Chombart de Lauwe a vécu le moment de la “métamorphose” comme une abolition de la hiérarchie sociale (« les conditions sociales, classe, profession, tout cela n’existe plus ») et comme une réduction de sa propre personne à l’essentiel, à « l’être » (26). Son intention de rester « digne sous les coups, sous l’attente, sous l’épuisement » (27) sera bientôt mise à l’épreuve. Au bout de quelques semaines, elle se rend compte que les conditions d’existence et de travail l’ont transformée en « bête traquée » (28) : « Heureusement que les nôtres ne nous voient pas, avec ces visages morts, ces yeux vides qui ont vu trop d’horreur, ces traits durcis et cette misère indescriptible. Jamais un être libre ne comprendra cette souffrance qu’on est pour soi-même : se sentir s’abrutir, s’abêtir, se machiniser, se vider peu à peu de sa vie. On ne le sent pas généralement, mais par moment, on a des reprises de conscience très dures » (29). Ce passage présente l’analyse lucide d’un processus de déchéance qui transforme le ‘soi’ en l'‘autre’, l’être humain en bête ou en chose, mais en même temps il met en relief l’ultime ressort de l’affirmation de soi, à savoir la honte qu’éprouve l’individu par rapport à son double concentrationnaire. Il est significatif que Chombart de Lauwe, après l’aveu de la propre déchéance, évoque une activité qui pourrait paraître sans importance : « Nous fabriquons de petits objets : croix, croix de Lorraine, étoiles, et nos numéros surmontés du triangle rouge. Ces petits objets sont les cadeaux pour les jours de fêtes, des témoignages d’affection : nous ne sommes pas encore des bêtes » (30). Cette activité minimale illustre parfaitement la possibilité d’une reconquête de l’humain dans un camp de concentration : fabriquer en groupe des objets pour se les donner en cadeaux les jours de fêtes signifie vaincre la réduction aux besoins corporels, briser l’égoïsme de la lutte solitaire pour la survie, surmonter l’indifférence et s’intéresser aux autres, bref : sortir de l’abrutissement.
Avant de passer à ma conclusion, je vous invite à jeter un regard sur l’évocation de la libération et du retour dans quelques récits de déportation. Au moment de la libération, il y eut dans beaucoup de camps une chasse aux kapos : « À 17 heures, les premiers règlements de compte commencèrent. Le chef du block 1, puis Karl, puis Le Tzigane, puis d’autres, furent exécutés sans ménagements : à coups de pierre, frappés, noyés, poignardés. Au total, une cinquantaine de kapos succombèrent le 5 mai au soir. Du sang encore du sang, des cris encore des cris. Mais ce retour de violence était inévitable. Trop d’horreurs avaient été commises pendant trop longtemps pour qu’elles puissent être assimilées sans réactions » (31). La plupart des auteurs français qui se souviennent de la libération du camp d’Ebensee, détaillent et justifient cette tuerie sauvage : « Si j’ai rapporté ces scènes, que les émotifs qualifieront d’atroces, ce n’est pas par gloriole, par sadisme rétrospectif. Nous avons exécuté nos ex-camarades en pleine connaissance de cause, sans erreur » (32). Il n’y a que l’abbé Varnoux qui écrit avoir gardé « un souvenir horrible » des « ‘règlements de comptes’ » (33). François Wetterwald, dans "Les morts inutiles", réfléchit longuement sur cette explosion de violence : « On a ouvert les ergastules. Des bêtes, des bêtes féroces. Les dompteurs sont partis. Les Américains nous ont dit solennellement : “Maintenant, vous êtes des hommes libres”. Libres, oui, mais des hommes ? » (34) Peut-on reprocher aux victimes le ‘lynchage’ de leurs oppresseurs ? On pourrait, je cite encore Wetterwald, « tout juste leur en vouloir, s’il s’agissait d’hommes normaux. Le plus grand crime des S.S. a été justement de tuer dans ces hommes tout ce qu’il y avait de spécifiquement humain » (35). La mise à distance de la masse (« ces hommes »), laisse entendre que l’auteur s’en excepte. Mais Wetterwald, se souvenant de sa propre indifférence envers les morts dans la fosse commune, se corrige aussitôt : « Voyez, moi non plus, je ne suis plus tout à fait un homme civilisé » (36).
En effet, les survivants qui rentrent en France ne sont pas, contrairement à ce que dit Debrise, médecin-prisonnier avec François Wetterwald au revier d’Ebensee, des « miraculés » qui « émergent intacts, semblables à ces canards dont l’eau de la mare n’a pas mouillé le plumage » (37). Cette déclaration sent le parti pris idéologique d’une époque qui ne voulait accepter que l’esprit pur et dur de la Résistance. En général, les survivants, même ceux qui justifient le lynchage des kapos, se rendent compte de leur perte d’humanité : « Nous étions des condamnés à mort, non en sursis d’exécution, mais tués un peu plus chaque jour par une organisation scientifique de la mort lente. On nous a enlevé beaucoup de nous-mêmes, que nous ne retrouverons jamais. Notre sensibilité, peut-être, ainsi que notre émotivité, mais très amoindries, notre sensiblerie jamais, pas plus que l’intégralité de nos forces physiques. Hommes comme femmes, nous sommes définitivement et profondément marqués » (38).
Homme ou bête ? – La lecture de plusieurs dizaines de récits de déportation m’a appris de préférer, au noir et blanc, les nuances infinies de la “zone grise” dont parle Primo Levi dans "Les naufragés et les rescapés". « Les camps », ce sont les paroles de Hannah Arendt, « étaient au service non seulement de l’extermination et de l’humiliation de l’individu, mais aussi de l’expérience terrible de supprimer, selon des principes scientifiquement exacts, la spontanéité humaine et de transformer l’homme en une chose qui dans les mêmes conditions répond toujours de la même façon » (39). Dans un système où tout concourt à rabaisser l’homme à l’état de bête, l’être humain s’affirme par le refus d’une survie purement physique, en s’efforçant de recouvrer, au moins par moments, des comportements qui transcendent l’utilitarisme de la lutte solitaire : raconter ses rêves, fabriquer des objets, partager une soupe ou aider un camarade malade. Ces comportements ne suffisent peut-être pas pour vivre et mourir en saint (« nous ne sommes pas des anges entre nous, même entre Français », écrit Degroote (40)), mais pour bien faire son « boulot d’homme ». Le boulot d’homme est donc la lutte quotidienne pour une humanité toujours menacée par l’abrutissement. André Malavoy, moins sceptique que Primo Levi, se dit, à la fin de son témoignage, « plus que jamais conscient de la grandeur de l’homme, de sa filiation divine, [mais] conscient aussi plus que jamais de sa dégradation possible. Nous avons vécu, bêtes parmi des bêtes féroces, les meilleurs d’entre nous ne pouvant éviter toujours les morsures de la Bestialité » (41). La découverte de la “vulnérabilité” de l’être humain est (si vous me permettez de résumer ainsi le résultat de mes lectures) une des leçons morales à tirer de l’expérience des camps. J’emploie à dessein le terme de ‘vulnérabilité’ qui est une notion clé de la philosophie d’Emmanuel Lévinas : « Le moi, de pied en cap, jusqu’à la moelle des os, est vulnérabilité. », écrit-il dans " Humanisme de l’autre homme "(42). La lecture des récits de déportation nous apporte l’image d’un humanisme jamais acquis, toujours à conquérir. L’immense valeur des témoignages est de nous montrer des individus qui résistèrent à la déshumanisation mise en oeuvre par les nazis, en vainquant l’égoïsme animal toujours aux aguets pour s’ouvrir, par des gestes humains, mais d’un humanisme quotidien, à l’Autre.
P. Kuon
BIBLIOGRAPHIE 2EME PARTIE :
(22) Jean Laffitte, Ceux qui vivent, Paris, Éditions Hier
et Aujourd’hui, 1947.
(23) Roger Heim, op.cit., p. 19.
(24) Bruno Bettelheim, « Comportement individuel et comportement de masse dans les situations extrêmes » (1943), in : B.B., Survivre, Paris, Robert Laffont, 1979, pp. 66-105, ivi p. 83.
(25) Paul Tillard, Mauthausen, Paris, Éditions Sociales, 1945,
p. 62.
(26) Marie-Jo Chombart de Lauwe, Toute une vie de résistance, Paris, Graphein-FNDIRP, 1998 (écrit 1945) p. 60
[Marie-Jo Chombart de Lauwe est la fille de Suzanne Wilborts].
(27) Ibid., p. 62.
(28) Ibid., p. 86.
(29) Ibid.
(30) Ibid., p. 96.
(31) Roger Gouffault, op.cit., p. 122.
(32) René Gille, op.cit., p. 79.
(33) Jean Varnoux, Clartés dans la nuit. La résistance de l’esprit. Journal d’un prêtre déporté, Naves, Éditions de
La Veytizou, 1995, p. 246.
(34) François Wetterwald, op.cit., p. 179.
(35) Ibid., pp. 175-176.
(36) Ibid., p. 176.
(37) Gilbert Debrise, op.cit., p. 187.
(38) René Gille, op.cit., p. 83.
(39) Hannah Arendt, « Die Konzentrationslager », in : H.A., Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, totale Herrschaft, Frankfurt/M., Fischer 102005 (1951), pp. 907-943, ivi p. 908 (ma traduction).
(40) Jean Degroote, op.cit., pp. 56-57.
(41) André Malavoy, La mort attendra. Souvenirs de guerre, Paris-Montréal, Les Éditions de l’Homme, 1961, p. 108.
(42) Emmanuel Lévinas, Humanisme de l’autre homme, Paris, Fata Morgana, 1972, p. 105.
 Sujets similaires
Sujets similaires» la bête de l'IJN I-400 et I-401
» Loi portant statut de l'incorporé de force [BE]
» c'est trés bête
» La bête immonde
» L'original du statut des juifs accable le Maréchal Pétain
» Loi portant statut de l'incorporé de force [BE]
» c'est trés bête
» La bête immonde
» L'original du statut des juifs accable le Maréchal Pétain
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum|
|
|